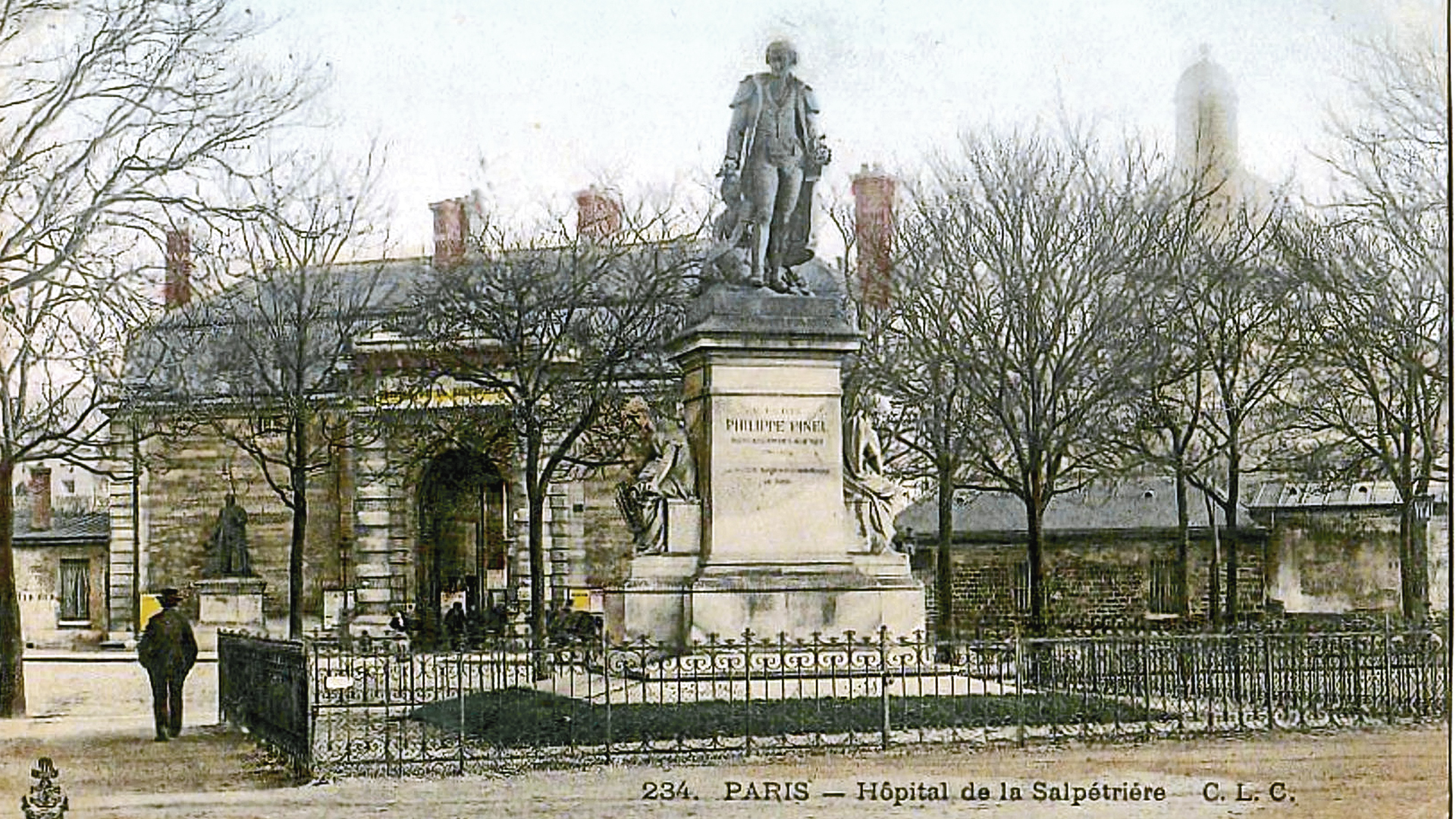Après l’ouragan
Explication du phénomène
L’accident de la rue de Patay. — Au Muséum d’histoire naturelle. — Ce que disent les savants.
La Patrie — 28 juillet 1896
L’ouragan qui s’est abattu hier soir sur Paris et les environs a causé de nombreux dégâts ; plusieurs personnes ont été blessées. On signale, jusqu’à présent, un seul cas de mort ; il s’est produit au lavoir du Progrès, 85, rue de Patay.

Cet établissement est tenu par les époux Bastide. Le ménage, n’avant pas d’enfants, adopta la nièce de Mme Bastide, la jeune Berthe Verniol, dont la mère était morte quelques jours après la naissance de l'enfant. Entourée des soins les plus affectueux, la fillette avait grandi auprès de ses parents adoptifs et de son père réel, qui a gardé à sa charge son second enfant.
— J'avais justement une noce à déjeuner chez moi, nous dit M. Sicard, dont le restaurant est voisin du lavoir. Lorsque le tonnerre est tombé, suivant immédiatement un immense éclair, nous eûmes la sensation d'un éblouissement et mes convives furent précipités hors de leurs chaises. En même temps, des cris épouvantables partaient de la cour, et quelques instants après M. Bastide, affolé, sortait de chez lui un revolver à la main, il voulait se tuer. Nous eûmes toutes les peines du monde à lui arracher larme.
Voici ce qui s’était passé : pendant que l'orage grondait, la petite Berthe qui venait de sortir d’ici avec un siphon, prenait un bain dans le lavoir. Sa mère, qui était en train de la nettoyer, se retira un instant pour fermer les fenêtres. Soudain le tonnerre tomba, entraînant la moitié de la grande cheminée, brisant la toiture, tuant l’enfant dans sa baignoire.
Une seconde avait suffi pour écraser Berthe, faire jaillir la cervelle, défoncer la poitrine. déchiqueter les mains...
Si l’orage avait éclaté un jour de semaine, c'eût été, dans le quartier, une épouvantable catastrophe.
Aujourd’hui, la douleur des malheureux parents est navrante. Mme Bastide, d’un tempérament extrêmement nerveux, ne cesse de gémir et de prononcer des phrases incohérentes. Si sa vie n’est pas menacée, sa raison, au dire de tous, est fortement compromise.
Quant au lavoir, il est en piteux état. Des poutres pendent, sciées toutes à la même hauteur ; les roues des essoreuses ont été coupées comme une feuille de papier, la toiture défoncée menace ruine et au-dessus s’élève bien le tronçon de la grosse cheminée.
Les époux Bastide avaient l’habitude d’aller passer le dimanche à Ablon. Ils n’étaient restés, hier, à Paris, que pour aller dîner chez un ami.
La consternation dans le quartier est générale.
La famille Bastide jouit de l’estime de tous et plus de trois mille personnes ont déjà défilé devant le lit mortuaire.
Au jardin des Plantes
Le jardin qui, l’autre jour, faisait l'admiration de Li-Hung-Chang, a été particulièrement éprouvé par l’ouragan.
Nous sommes allés le visiter ce matin ; il est dans un lamentable état : le sol est jonché de feuilles et de branches, le gazon des pelouses est couché, des arbres vigoureux ont été coupés comme avec une sache, d’autres ont été déracinés.
— Ce sont précisément les arbres les plus beaux que la tourmente a abattus, nous dit le commandant Clavel qui veut bien nous servir de cicérone et nous donner quelques renseignements.
Et le commandant, navré, nous montre de gros arbres qui gisent sur le sol, et que des ouvriers sort occupés à scier et à dépouiller de leurs branches.
— Fort heureusement, ajoute-t-il, le labyrinthe, où se dressent un certain nombre d’arbres précieux, a été à peu près épargné. En revanche, toute la partie du jardin qui longe la rue Cuvier a cruellement souffert de la tourmente. De ce côté, les dégâts sont considérables.
— Aucun des animaux du jardin n'a été tué ou blessé ? demandons-nous au commandant.
— Non, et cela est très étonnant. Mais ce qui me surprend davantage encore, c’est que nous n’ayons pas eu d'accident de personnes à déplorer. Il y avait beaucoup de monde dans le jardin, quand l’ouragan, avec une violence extrême, s’est soudain déchaîné. La panique a été grande parmi les promeneurs ; en quelques secondes, tous se sont éclipsés comme une nuée de moineaux.
— À combien évalue-t-on les dégâts, mon commandant ?
— On ne le sait pas encore ; mais il faut bien compter de douze à quinze mille francs au bas mot.
En traversant le jardin, nous croisons d’innombrables tombereaux dans lesquels des équipes d’ouvriers entassent les branches et les feuilles tombées des arbres.
Au bureau météorologique
Au bureau météorologique, 176, rue de l’Université, on nous a donné les explications suivantes :
— Ce n’est pas un cyclone, comme l’ont prétendu quelques-uns de nos confrères, qui a mis Paris en émoi hier : c’est simplement un très violent orage, dû à une de ces dépressions secondaires qui, comme des satellites, accompagnent, en général, toute dépression principale. Nous connaissions par vitement l’existence de cette dernière qui, samedi, à sept heures du matin, nous était signalée au sud de l'Irlande. Nous pensions quelle elle allait descendre sur la Bretagne, mais elle s'est subitement reportée vers le nord et, vingt-quatre heures après, c’est-à-dire dimanche matin, elle était sur l’Ecosse, paraissant vouloir se diriger vers la Norvège.
Comme à ces dépressions principales, qui font parfois descendre le baromètre jusqu’à cinquante centimètres, sont toujours liées des dépressions secondaires, orageuses, qui les avoisinent, mais toutefois sans se mouvoir dans le même sens qu’elles, et qui sont caractérisées par des effets météorologiques bien plus redoutables que la dépression principale elle-même ; hier, dès dix heures du matin, nous avions averti toutes les communes de France de la possibilité d’un orage.
Sa violence à Paris et dans la banlieue nous a surpris, nous devons l'avouer. Le baromètre qui, depuis trois heures de l'après-midi avait baissé jusqu'à 756 millimètres est brusquement remonté à quatre heures, comme toujours, du reste, en pareil cas, au moment où l’orage était à son apogée.
Mais, répétons-le, il n'y a pas eu de cyclone ou, si vous l'aimez mieux, de tourbillon de vent. Le vent qui, sur le sol, à quatre heures, avait une vitesse de sept mètres à la seconde, en avait, au même moment, une effrayante de vingt-cinq mètres au sommet de la tour Eiffel.
En passant, nous pouvons dire que la résistance de la tour à pareille poussée est une preuve incontestable de sa grande solidité.
Pour en revenir au vent, celui-ci n’a nullement tourné ; il a toujours soufflé du nord, ouest au sud-est, et, aujourd’hui encore, sa direction est à peu près la même qu'hier, ce qui ne serait certainement pas, s’il y avait eu un cyclone.
Nous n'avons pas encore les renseignements de la province sur la marche et sur les dégâts occasionnés, mais nous prévoyons que ces dégâts ont dû être beaucoup moindres qu’à Paris, où l’agglomération des maisons et de la population les a rendus fort sérieux.
D'ailleurs, tous les cultivateurs étaient prévenus par nous delà possibilité d’un orage et ils ont pu prendre leurs précautions. C’est, en effet, dans un but de prévision pour l’agriculture que nous travaillons surtout ici. Seulement, notre travail est rendu souvent fort difficile par suite du manque de renseignements. Ainsi, nous enregistrons une dépression qui nous est signalée dans l’Amérique du Nord et qui a l'air de vouloir s'étendre à l'Europe, en suivant une certaine direction. Nous l'attendons donc à un point donné des côtes de France et voilà qu’elle se présente en un tout autre point, ayant changé de direction pendant la traversée de l’Atlantique. Il nous faudrait donc avoir des postes au milieu de l’Océan, des pontons-vigies comme en ont placés les Anglais dans la mer d’Irlande pour les mêmes motifs. Malheureusement, pareille installation coûterait, paraît-il, fort cher à l’État et notre part au budget est tout à fait petite, trop petite même.
Nous enregistrons volontiers les doléances de cette savante institution, qui rend à la culture française d’incontestables services.
Louis Berville.
Sur la rue de Patay
Historique
La rue de Patay (695 mètres, entre le boulevard Masséna, et la rue de Domrémy, 25) fut ouverte par arrêté préfectoral du 21 novembre 1855, sous le nom de boulevard de Vitry. Elle faisait alos partie de la commune d'Ivry.
Par décret du 2 octobre 1865, elle reçut sa dénomination actuelle, à cause du voisinage de la place Jeanne-d'Arc, et en mémoire de la victoire que Jeanne remporta sur les Anglais de Talbot en 1429. (Petite histoire des rues de Paris, 1913)
En lien avec la rue de Patay
- L'accident de la rue de Patay (1896)
- Une maison qui se déplace (1897)
- L'école de la rue de Patay (1897)
Faits-divers
- Le drame de la rue de Patay (1892)
- Le mystère de la rue de Patay (1901)
- La maison hantée ou les esprits « frappeurs » (Le Petit-Parisien, 7 avril 1920)
- Des « esprits » persécutent une famille rue de Patay (Le Petit-Journal, 8 avril 1920)
- La Maison « hantée » de la rue de Patay (La Lanterne, 8 avril 1920)