L'image du jour

... et face à la Raffinerie Say, le tout avant la construction de la ligne 6 du métro.
Les rails que l'on devine au premier plan, en bas à droite, sont ceux du tramway venant de la rue Jeanne-d'Arc.
![]()
UNE ÉVOCATION DU
13e ARRONDISSEMENT DE 1860 AUX ANNÉES 30

Faits divers
La 11e chambre a jugé hier une victime de la traite des blanches devenue traitante à son tour, bien que n'ayant encore que dix-huit ans. Mais les voyages ont si bien réussi à Thérèse Champré qu'elle a pu déjà s'établir.
C'est dans l'Alaska qu'après avoir successivement visité le Brésil et le Transvaal, Thérèse Champré a fixé ses pénates, à l'abri d'un débit de whisky d'autant plus toléré que Thérèse Champré a pour associé le chef même de la police de l'endroit.
Devenue patronne, Thérèse Champré s'avisa d'une remplaçante et s'en vint récemment à Paris, où, d'ailleurs, par la même occasion, elle se faisait une joie d'embrasser sa vieille mère. Elle n'eut pas longtemps à chercher.
Une raffineuse de l'usine Say, rencontrée par elle, avenue des Gobelins, l'avait accueillie comme une providence, en avant assez, déclara-t-elle, de travailler pour trente sous par jour. D'autant que Thérèse Champré avait aussitôt acheté à la jeune fille six chemises de nuit, six de jour, douze paires de bas et douze mouchoirs, cinq jupons de soie, trois camisoles, dix cache-corsets, deux jupons blancs, et pas moins de cinq paires de chaussures, dont deux de satin blanc.
Mais la sœur de la jeune ouvrière prévint la police, qui arrêta Thérèse Champré au moment où elle allait monter en wagon pour le Havre, accompagnée de sa recrue.
Thérèse Champré a été condamnée à six mois de prison, malgré les déclarations de la jeune raffineuse, assurant qu'elle n'eût pas mieux demandé que de faire le voyage.
À lire également...
Quartier Croulebarbe
1937
Il n'est question dans le quartier Croulebarbe (XIII* arrondissement), que d'une histoire de détournement de charbon, dont ce qu'on en a pu savoir, suffit à faire le mystère dont on l'entoure volontairement.
...
Quartier de la Maison-Blanche
1898
La rue des Malmaisons, inconnue de bien des Parisiens, est située avenue de Choisy, le long du chemin de fer de ceinture. À part quelques commerçants de détail, elle est habitée presque exclusivement par des ménages de chiffonniers.
...
Quartier de la Maison-Blanche
« Entends-tu ma voix qui t'invite ? » - 1905
1905
Jean Rousseau, dit « Guibollard », dix-neuf ans, et Lucien Fraisier, dit le « Petit-Rat », seize ans, avaient résolu d'offrir à leurs amis de la poterne des Peupliers un repas à l'instar de ceux que s'offrent les bourgeois.
...
Place des Peupliers
Des agents de police chassent un renard à coup de pèlerines
1939
Les enfants en venant jouer, hier vers 8 heures, dans le petit square situé au centre de la place des Peupliers (13e), aperçurent, à leur grand effroi, un renard dans les massifs...
...
Saviez-vous que... ?
En 1920, on pouvait trouver un avertisseur public d''incendie à l'angle des rues Watt et du Chevaleret ainsi qu'au 31 quai de la Gare.
*
* *
En 1890, le quartier Croulebarbe comptait deux maisons de tolérance, celle de Mme Rouau au 9 boulevard d'Italie et celle de Mme Turquetil au 11 du même boulevard. Le quartier Maison-Blanche n'en comptait aucune.
*
* *
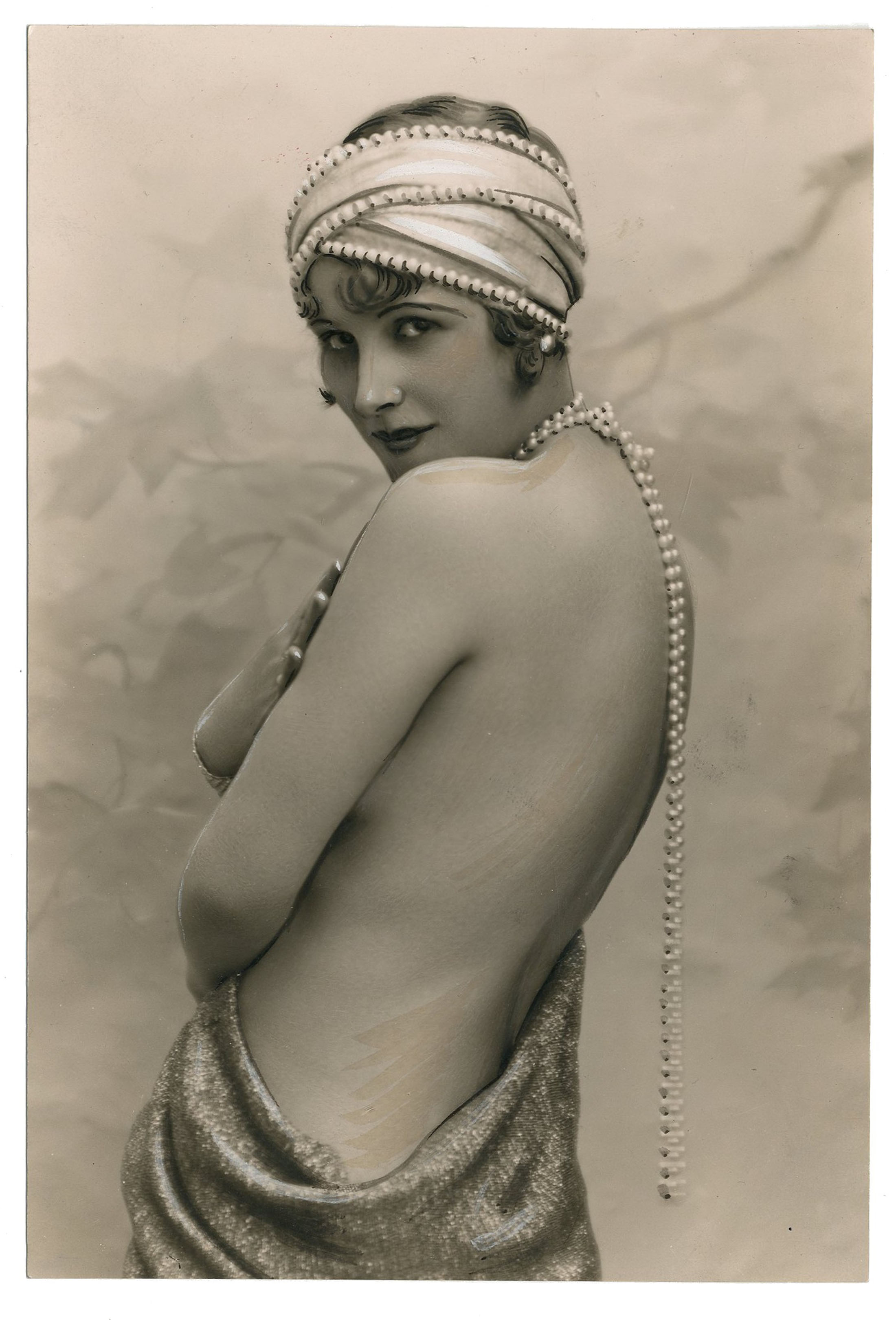 Dans la semaine du 15 au 22 mars 1929, le cinéma Clisson Palace (61-63 rue de Clisson) jouait "Trois jeunes filles nues", un film avec la charmante Jeanne Helbling que celle-ci avait tourné avec l'excellent Nicolas Rimsky. Jeanne Helbling partageait la vedette avec Mmes Jenny Luxeuil Jeanne Brindean et Annabella.
Dans la semaine du 15 au 22 mars 1929, le cinéma Clisson Palace (61-63 rue de Clisson) jouait "Trois jeunes filles nues", un film avec la charmante Jeanne Helbling que celle-ci avait tourné avec l'excellent Nicolas Rimsky. Jeanne Helbling partageait la vedette avec Mmes Jenny Luxeuil Jeanne Brindean et Annabella.
*
* *
En 1849, face à la barrière des Deux-Moulins, sur le territoire de la Commune d’Ivry, dans la rue principale qui allait devenir la rue Nationale, deux bals se faisaient concurrence : La Belle Moissonneuse au 31 (ancienne numérotation), propriété de M. Latruffe et La Belle-Jardinière exploité par M. Cudat qui fut remplacé par Le Grand Vainqueur.
Le bal de la Belle-Moissonneuse accueillit de nombreuses réunions politiques de 1848 jusqu’en 1876 et ferma ses portes peu après.

... et face à la Raffinerie Say, le tout avant la construction de la ligne 6 du métro.
Les rails que l'on devine au premier plan, en bas à droite, sont ceux du tramway venant de la rue Jeanne-d'Arc.