Episode # 19
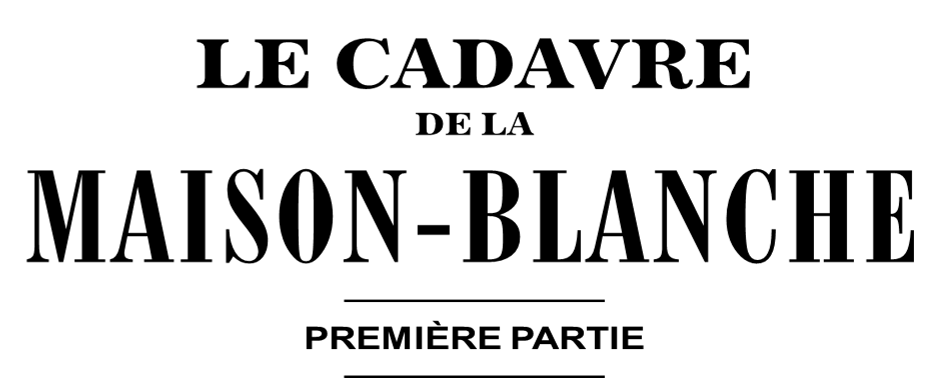
VIII
Comment les bons comptes font les bons amis
(suite)
Ainsi mis à l'aise, Raulhac ne se fit pas prier davantage.
Il déposa le portefeuille sur une table et l’ouvrit.
Sa vérification terminée, il reprit les liasses de billets qu’il avait, à mesure qu’elles étaient comptées, déposées sur la table.
Il les réintégra dans le portefeuille, ferma ce dernier, le fit glisser au plus profond d’une poche de sa redingote et, par-dessus, boutonna soigneusement son paletot.
— Marcel, dit-il d’un ton sérieux, avec une émotion qui n’était point feinte, à présent c’est entre nous à la vie à la mort ! Si jamais tu as besoin de moi, tu sais où me prendre ; tu me trouveras prêt.
Les deux amis échangèrent une cordiale poignée de mains.
— Tu es tout de même un heureux coquin, reprit Raulhac. Tu as gâché ta vie à plaisir, et à présent tu peux la recommencer à nouveau, et te la refaire plus belle qu’elle n’eût été si tous ces événements n’étaient pas survenus.
— J’y tâcherai du moins, répondit Marcel en souriant.
Et, après un silence, il ajouta :
— Quand retournes-tu à Bordeaux ?...
— Ce soir, sans doute. Demain matin au plus tard.
— Le plus tôt sera le mieux, reprit Marcel. Il est nécessaire, pour notre sécurité matérielle, qu’on n’ait pas le moindre soupçon de ne qui vient de se passer entre nous et tu ne t’étonneras pas, Raulhac, que je ne te donne pas de mes nouvelles d'ici à quelque temps. Il faut, par prudence, demeurer jusqu’à nouvel ordre étrangers l’un à l'autre.
Raulhac cligna de l’œil d’un air malin.
— Ne crains rien, dit-il. Si cependant j’avais à t’écrire au sujet de Mme Berthe…
— M’écrire ! s’écria Marcel. Y songes-tu, malheureux ! Il faudrait simplement me prévenir par un télégramme que tu as à me parler d'affaires. J’aviserais. Mais je ne vois pas, ajouta-t-il d’un ton froid et hautain, ce qu’il peut y avoir désormais de commun entre Berthe et moi.
Raulhac s’était dirigé sur la porte.
Marcel le reconduisit jusque sur le perron, de l’hôtel, et ne le quitta pas du regard qu’il n’eût vu la grille de la cour se refermer derrière lui.
Rentrant alors dans le vestibule et s’adressant au domestique qui s’y tenait dans l’attente de ses ordres :
— Toutes les fois que ce monsieur viendra me demander, lui dit-il, vous répondrez que je suis en voyage ou que je viens de sortir.
Il revint ensuite dans son cabinet et se rassit au coin du feu d'un air froid et pensif :
— Tu ne te trompes pas, mon bon Raulhac murmura-t-il. Je vais, en effet, me refaire une vie nouvelle et pour commencer, je me débarrasse des complices de l'ancienne.
X
Prisonnière !
Le même jour, vers quatre heures du soir, une autre scène se passait dans le village espagnol où Raulhac avait conduit Berthe Percieux.
Assise près d’un bouquet d’orangers, dans le jardin de l’habitation où elle vivait captive, la malheureuse femme regardait d’un air mélancolique le soleil prêt à disparaître à l’horizon dans une brume dorée, tandis que son fils, insouciant du passé comme de l’avenir, jouait gaiement à ses pieds.
Des horizons lointains, où il se perdait comme pour y chercher des lueurs d’espérance, le regard de Berthe retombait parfois sur les murailles du jardin, infranchissables pour ses faibles forces, et alors son attitude mélancolique devenait plus affaissée encore ; sur son visage, où l’on voyait les traces de larmes mal essuyées, de nouveaux pleurs coulaient lentement.
Lorsqu’ensuite il se reportait sur la maîtresse de la maison, sa geôlière, alors occupée à des travaux rustiques dans le fond du jardin, un frisson de crainte et de répulsion courait dans ses membres amaigris.
Cette femme ayant bientôt repris le chemin de la maison, Berthe baissa les yeux et parut uniquement occupée de la broderie qu’elle tenait à la main et à laquelle elle ne travaillait guère.
Son hôtesse était âgée d’une cinquantaine d’années, de petite taille, et chargée d’un assez fort embonpoint. Son teint couleur de citron, ses traits accentués et durs, son regard sombre et pénétrant, ses cheveux noirs et déjà mêlés de fils d’argent, donnaient à sa physionomie un air sinistre, presque menaçant.
Arrivée près de Berthe, elle la contempla quelques instants d'un regard aiguisé par le soupçon, puis l'apostrophant d'un ton sec et dur :
— Il faut rentrer, madame, dit-elle en français, avec un accent très marqué. La nuit approche et le vent fraichit Vous pourriez, votre fils ou vous, prendre froid et je n’entends pas que vous vous rendiez malades à plaisir. Je réponds de vos santés comme de vos personnes.
Berthe ne leva docilement et d’un mouvement presque craintif :
— Le soleil est encore haut, dona Mercédès, dit-elle d'un ton doux et conciliant. Je vais cependant rentrer, puisque vous le désirez. Mais auparavant, je vous demande la permission de vous adresser une question.
— Je vous écoute, dit dona Mercedes, dont le visage prit soudain une expression de rigidité imperturbable.
Berthe pâlit et rougit successivement ; puis, s'armant de courage :
— Vous m'avez promis, madame, dit-elle, lorsque vous recevriez des nouvelles de mon mari, de m'en donner, de me dire aussi pour quoi il m’a condamné à cet exil et quand mon éloignement prendra fin.
Le visage de dona Mercédès s'assombrit, et ses sourcils, déjà fort rapprochés, se confondirent au point de former au-dessus de ses yeux un arc unique, qui donnait à sa physionomie un air étrange et menaçant.
— Je ne vous ai rien promis de semblable, répliqua-t-elle d’un ton sec. Je vous ai dit que si les lettres que je reçois contiennent des nouvelles de nature à vous être communiquées, je ne vous les cacherai pas, voilà tout !
Le visage de Berthe prit une expression suppliante.
— Celle que vous avez reçue hier ne contenait donc rien de semblable ? demanda-t-elle.
— Non, puisque je ne vous ai rien dit, répliqua durement l'Espagnole.
Puis, regardant la jeune femme d’un air soupçonneux, où l'ironie se mêlait à la colère :
— Mais qui donc vous a dit que j’avais reçu cette lettre ? ajouta-t-elle.
— Personne, madame, dit Berthe en baissant les yeux.
— Alors, comment le savez-vous ?
— Je vous ai vu la lire. J'ai reconnu les cachets et les timbres de la France.... Il ne faut pas m'en vouloir si je m'en suis aperçue, ajouta-t-elle d'un air timide et doux. Je souffre tant dans la solitude où je vis, d'être réduite à cette incertitude, de ne pas savoir pourquoi l’on me retient ainsi prisonnière, ni si je reverrai jamais mon pays et mon mari. Il est dur madame, d’être ainsi traitée quand on a la conscience de ne l’avoir pas mérité. Vous devez le comprendre.
L’Espagnole haussa les épaules.
—Moi ! dit-elle. Je n’entends rien à toutes ces jérémiades, et si j’ai un conseil à vous donner, c’est de les épargner à vous-même et aux autres. Elles excitent votre esprit, au lieu de le calmer, et bien loin d'abréger votre séjour ici, elles finiront, si vous continuez, parle rendre définitif.
— Oh ! ne dites pas cela, dona Mercédès, s'écria Berthe en prenant les mains de l’Espagnole et en les serrant dans les siennes. Vous ne savez pas quel mal vous me faites !
Et comme l’Espagnole restait insensible à sa douleur, elle ajouta d’un ton où elle semblait mettre toutes les supplications de son âme :
— Puisque mon mari ne vous dit rien de moi dans ces lettres, soyez assez bonne, je vous en conjure, pour le prier en mon nom de vous parier de moi, de me donner de ses nouvelles, de répondre surtout aux demandes que je ne cesse de vous adresser. Dites-lui que l’incertitude dans laquelle il me laisse est une torture dont je souffre nuit et jour, et que j'en serais morte, si la pensée de mon fils ne me soutenait pas et ne me donnait encore le courage de vivre.
— Votre mari, dit dona Mercédès d’un ton très lent, en arrêtant son regard immobile et noir sur les yeux de Berthe, comme si elle voulait la fasciner. De qui voulez-vous donc parler, madame ?
— Mais, répondit Berthe d'un air étonné, de M. Marcel Percieux.
— Ah ! vraiment ! répliqua l’Espagnole d’une voix pleine de colère et de menaces. Venez alors, madame.
Et, la prenant par la main, elle la conduisit vers une des portes du jardin qui donnait sur la campagne ; elle ouvrit cette porte et lui montra un édifice d’aspect sombre et triste qui dressait ses hautes murailles au milieu d'on vaste parc, à l’horizon.
— Vous voyez bien cet établissement ? dit-elle à demi-voix.
— Sans doute.
— Vous savez à quel usage il sert ?
— Non, madame.
— C’est l’hôpital des fous.
— Ah ! dit Berthe, dont le cœur, involontairement, se serra.
— Oui, l’hôpital des fous, repartit dona Mercédès en fixant sur la malheureuse femme un regard si dur et si implacable, que Berthe se sentit défaillir, et maintenant, écoutez bien ce que je vais vous, dire ; Si jamais il vous arrive de prononcer ici le nom de M. Marcel Percieux et de dire que vous êtes en femme, vous serez enfermée jusqu’à la fin de vos jours dans cet établissement, et votre fils, dont on vous séparera, sera conduit dans un hospice d’orphelins. À présent, allez, ajouta-t-elle en fermant la porte avec violence ct en repoussant Berthe du côté de la maison. Allez, et souvenez-vous bien que je ne menace jamais en vain et que rien ne pourrait vous soustraire au sort qui vous attend.
Berthe était si pâle ct si épouvantée, qu’elle ne trouva pas une parole à répondre.
Elle prit la main de Jules qui avait assisté à cette scène d'un air étonné, sans y rien comprendre, et l'entraîna dans sa chambre.
Puis, quand elle l'eut couché dans son petit lit et que l’enfant se fut endormi paisiblement, elle tomba à genoux près de son chevet.
— Mon Dieu ! murmura-t-elle, mon Dieu ! que je souffre ! Ahl mon pauvre enfant, si je n’avais pas à veiller sur toi, comme je voudrais être morte !
Et cachant son visage dans la couverture pour étouffer ses sanglots, elle resta une partie de la nuit dans cette attitude désolée, cherchant dans son cœur et dans la prière, non l’oubli, mais l’apaisement de ses douleurs.
FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
(A suivre)

 Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.
Ernest Rousselle (1836-1896) -C'est lui ! - et son fils Henri (1866-1925) étaient négociants en vins.