Un Coin du Vieux Paris victime de la Guerre
Les annales politiques et littéraires — 17 juin 1917
Flânerie à travers le quartier des Gobelins –– Le pavillon de Julienne — Les bords de la Bièvre — Paysages abolis
« Dépêchez-vous... On est en train de ruiner les ruines du charmant pavillon de Julienne... et vous arriverez trop tard. »
Le très artiste ami de Paris qui nous donnait ce renseignement exagérait, Dieu merci ! Le lendemain même du jour où il sonnait ainsi l'alarme, nous gagnions le lointain quartier des Gobelins où, derrière les ateliers de la manufacture de tapisserie, dans le prolongement de ce qui fut jadis la chapelle, se dresse — pas bien haut — le petit pavillon dit de Julienne, pavillon sculpté, enguirlandé de vignes, étayé de sureaux, dont l'élégante silhouette étonne et détonne dans le paysage de désolation qui l'entoure.
« En 1688, écrit Piganiol de La Force, dans sa Description de Paris, les sieurs Glud et Julienne établirent aux Gobelins une manufacture pour teindre les draps en écarlate ou en bleu, qui a parfaitement réussi. »
Neveu et successeur de ces habiles teinturiers, dont les établissements voisinaient avec ceux d'Etienne Gobelin, Jean de Julienne continua les affaires de ses oncles Jean Gluck (non Glud) et François de Julienne.
Ami et protecteur de Watteau, très averti en matière d'art, décoré de l'ordre de Saint-Michel, nommé « conseiller honoraire amateur » par l'Académie, Jean de Julienne fit très probablement édifier, vers le milieu du dix-huitième siècle, le joli pavillon dont il s'agit. Délabre depuis des années, ce pavillon est, lui aussi, une victime de la guerre, de la « petite guerre » tout au moins. Les Poulbot de la ruelle des Gobelins l’ont bombardé à coups de grosses pierres et l'une des figures sculptées faisant partie de la frise encadrant l'une des trois fenêtres a perdu son nez dans la bataille...

Les bords de la Bièvre et la ruelle des Gobelins ne sont pas inscrits parmi les excursions familières aux Parisiens. Ce quartier, d'aspect farouche, n'est pas de ceux où la flânerie s'impose ; son éloignement en fait un véritable déplacement, mais ce déplacement n’en reste pas moins plein de charme et nous ne saurions trop le recommander à ceux qui s'efforcent d'user en longues randonnées leur inactivité forcée. Rien, d'ailleurs, n'est propre aux rêveries et aux évocations comme ces promenades auréolées de souvenirs à travers les vestiges du vieux Paris.
Qu'il nous soit donc permis de proposer un itinéraire à ceux que tenterait l'expédition :
Entre le numéro 15 et le numéro 17 du boulevard Arago, une petite rue: la rue des Marmousets... Une largeur de maison à franchir et nous voici rue des Gobelins. À gauche, au numéro 17, au fond d'une cour, un très vieil hôtel de noble allure, édifié sur l'emplacement de la demeure somptueuse occupée par Blanche de Castille, mère de saint Louis, hôtel supprimé à la suite d'une terrible catastrophe connue dans l'histoire sous le nom de « Bal des Ardents » (1392). Quelques jeunes fous, recouverts d'étoupes pour se donner les allures d'hommes sauvages, brulèrent durant la fête « comme flambeaux ardents ». Cet épouvantable spectacle acheva de détraquer les facultés mentales du roi Charles VI et il fut ordonné que le logis « où advinrent les choses susdites » serait abattu et démoli. Ce fut seulement au commencement du dix-septième siècle qu'on construisit la demeure dont nous admirons la silhouette encore élégante, malgré les vilaines adjonctions, la cheminée d'usine et les modifications utilitaires qui la surchargent.

Après cet arrêt rapide, revenons sur nos pas et pénétrons dans la ruelle des Gobelins, qui s'ouvre derrière le numéro 26 de la rue des Gobelins. C'est là que, dépendant de la corroierie Chollet, se rencontrent, au numéro 7, derrière une porte cochère, les restes du pavillon de M. de Julienne, et c'est par-dessus cette porte qu'ont eu lieu les bombardements. La concierge du logis en sait quelque chose... La pauvre a dû faire grillager sa propre fenêtre :
« Que voulez-vous, monsieur, dit-elle pour les excuser, les enfants d'ici ont la guerre dans le sang... Ils sont ardents et vifs... Ils se prennent au sérieux et cognent dur... Ces pierres, dont le sol est semé, leur servent de projectiles... Nous devons, hélas ! subir les horreurs de la «petite guerre », et ce sont les pavés qui ont fait au pavillon les blessures que vous allez constater. »

La porte tourne sur ses gonds. Nous voici devant les restes de l'artistique pavillon, fleur de pierre émergeant de plâtras, de décombres semés de mâchefer.
Mais dans ce triste paysage, la nature, la divine nature a repris ses droits... Les feuilles et les fleurs ont tissé leurs tapis diaprés ; derrière un mur de pierres effritées les vignes poussent leurs pampres d'émeraude, les roses trémières et les soleils d'or commencent de fleurir... Tout cela provient des jardins d'études des Gobelins, épanouis à quelques pas d'ici, et ces paquets de verdure, poussés entre deux tas de scories, sont nés de quelques graines semées au hasard du vent ou par le caprice d'un vol de pierrots chapardeurs.
Les temps sont lointains où la Bièvre, sous la lumière du ciel, reflétait les nuages bougeurs... Les guinguettes bordant ses berges s'appelaient alors « la Belle Moissonneuse », « le Grand Vainqueur », « les Deux Edmond », bouchons bucoliques où les amateurs de gaieté champêtre se délectaient à boire du vin doux, à jouer au cochonnet, à danser au son des crincrins... Elle est depuis longtemps périmée l'époque où Alfred Delvau nous dépeignait le quartier comme « formant une sorte de petite Suisse en miniature, une vallée verdoyante où coulait la Bièvre entre deux bordures de saules » ; où Victor Hugo écrivait : « C'est le seul endroit où Ruysdaël serait tenté de s'assoir... Des palissades délabrées, un peu d'eau entre des peupliers, des femmes, des rires, des voix ; à l'horizon, le Panthéon, le Val-de-Grâce, noir, trapu, fantasque, mais magnifique, et, au fond, le sévère faîte carré des tours de Notre-Dame. »

Bien avant la guerre, les tanneries avaient déjà pris possession du quartier : une forte odeur de cuir travaillé emplissait l'espace ; des cuves de tan, rouges comme du sang, s'étalaient à droite et à gauche, où macéraient des peaux d'animaux fraichement écorchés, et la Bièvre, comprimée entre ses rives étroites, coulait des eaux empuanties, tour à tour teintes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, suivant la besogne à laquelle l'asservissaient les mégissiers qui l'avaient captée, utilisée, emprisonnée. Aujourd'hui, la Bièvre n'apparait plus ; elle chemine sous terre, invisible et comme honteuse.
Mais il convenait d'expliquer que les talus actuels, les agrafes, les rampes de fer rongées de rouille, les escaliers biscornus correspondent aux emplacements d'anciens canaux, d'anciens ponceaux, d'anciennes vannes. On a recouvert les canaux, supprimé les vannes, masqué les ruisseaux ; mais les rampes, les parapets, les escaliers subsistent.., et c'est un véritable paysage de guerre que forment ces venelles sordides, ces maisons lézardées, ces cheminées noires, ces sentiers défoncés, ces boues à odeurs fortes, ces bâtisses à clairevoie où sèchent des milliers de peaux de lapins racornies, qui, sous le vent, s'entrechoquent avec des cliquetis de castagnettes... Et comme nous sortions, notre bonne chance nous fait rencontrer l'excellent M. Chollet :
« Alors, mes vieilles pierres vous intéressent ?... Eh bien, je les donne à Paris. On pourra les faire prendre quand on voudra !
— Avec les sureaux ?
— Avec les sureaux ! »
Vive M. Chollet !
GEORGES CAIN,
Conservateur du Musée Carnavalet.
A lire également

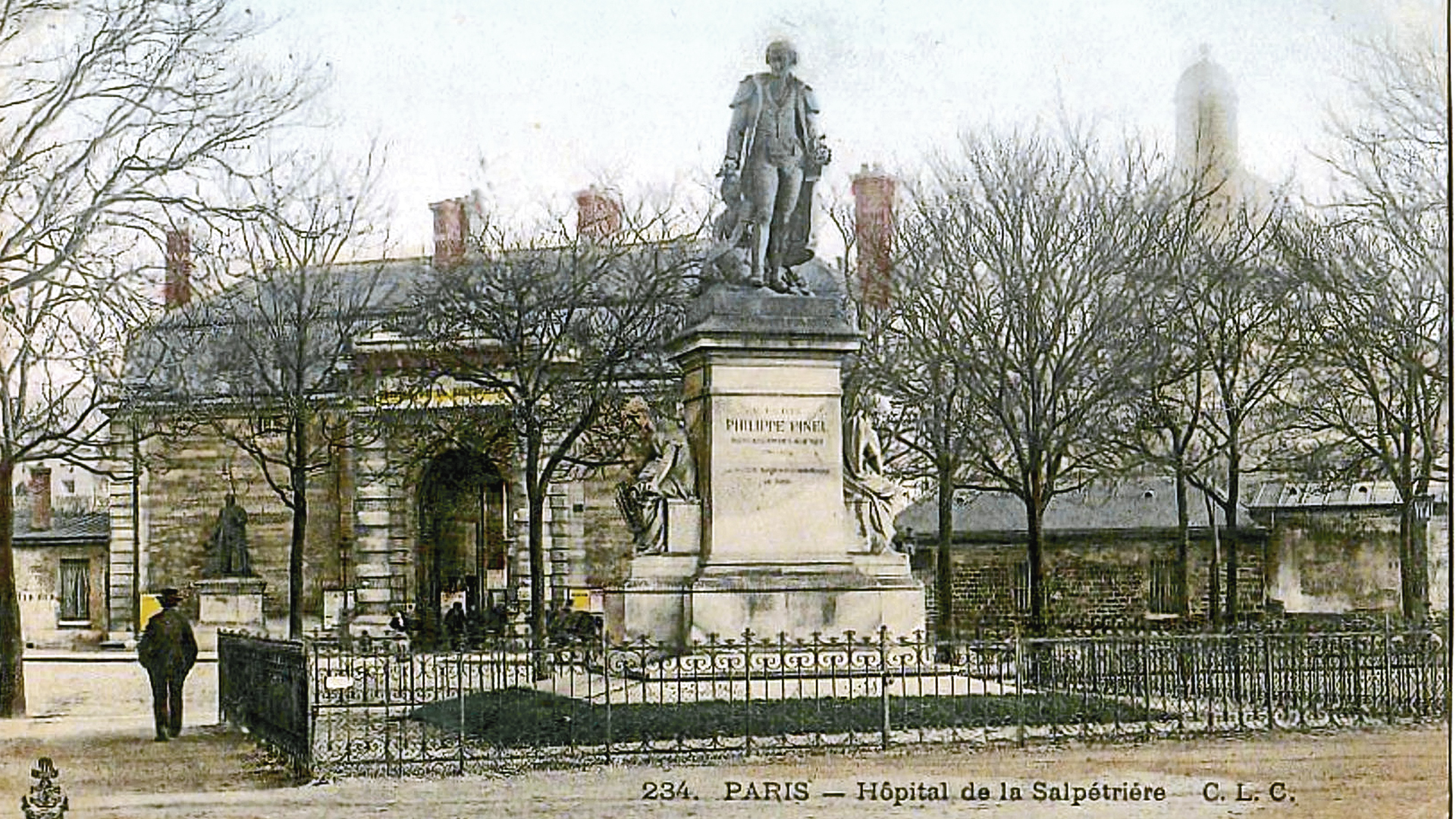
 Pierre et Marie Curie, au moment où ils reçurent le prix Nobel de physique « en reconnaissance de leurs services rendus, par leur recherche commune sur le phénomène des radiations découvert par le professeur Henri Becquerel », habitaient au 108 du boulevard Kellermann, alors bordé par les fortifications crêtées de gazon vert, une petite maison dont la façade de brique rouge s’abritait derrière un minuscule jardinet, nid de verdure dont le silence était propice aux méditations scientifiques.
Pierre et Marie Curie, au moment où ils reçurent le prix Nobel de physique « en reconnaissance de leurs services rendus, par leur recherche commune sur le phénomène des radiations découvert par le professeur Henri Becquerel », habitaient au 108 du boulevard Kellermann, alors bordé par les fortifications crêtées de gazon vert, une petite maison dont la façade de brique rouge s’abritait derrière un minuscule jardinet, nid de verdure dont le silence était propice aux méditations scientifiques.