La profession de cambrurier
Le Journal — 9 août 1901
Deux commis voyageurs, arrêtés hier après-midi dans un bar de la rue de Tolbiac, discutaient devant les deux bocks qu’ils avaient commandés pour étancher leur soif.
Bientôt la discussion s'envenima à un tel point qu'après des injures des coups allaient certainement être échangés, si de nombreux curieux que les éclats de voix avaient attirés n'avaient séparé les deux hommes.
« Oui, criait l’un, tu ne sais pas ce que tu dis, Paris a de ces surprises et tu es si peu intelligent que tu peux ignorer ce que c'est qu'un cambrurier. Mais moi je le sais... C'est écrit. Lis donc ça, tu t'instruiras. » Et, à l'appui de son dire, il développait un journal du soir dans lequel on pouvait lire, sous le titre « Les drames du jour » : « L’homme et la femme exercent la profession de cambrurier. On ignore généralement quel est ce métier. Il consiste tout simplement à polir des rails de chemin de fer avec du papier de verre, et les ouvriers qui se livrent à ce travail gagnent vingt centimes par mètre de rail poli. »
Ce fut alors un long éclat de rire d’autant plus prolongé que quelques cambruriers, employés comme on le sait à former la cambrure des souliers, au moyen d'outils spéciaux dans différentes fabriques de chaussures, se trouvaient mêlés à la foule.
La définition bizarre de ce métier très répondu dans ce quartier n'a d'ailleurs pas tardé à circuler et partout on faisait des gorges chaudes de l'explication du commis voyageur qui, rendu à l’évidence, ne savait comment se tirer honorablement d'une situation qui l'avait rendu ridicule.
Les recherches en vue d'identifier le journal du soir qui aurait donné une
si drôlatique définition de la profession de cambrurier sont restées vaines. En revanche, il
exact que la profession de cambruriers était bien représentée dans le XIIIe arrondissement où
l'industrie de la chaussure était fortement implantée avec par exemple l'usine Savart rue Rubens, des
ateliers d'habillement militaire du côté de la rue Croulebarbe ou encore des
usines boulevard Kellermann à proximité de la porte d'Italie.
La publication
ci-après reproduite témoigne de l'importance de la profession de cambrurier
en remarquant au passage, que c'est une autre définition, la vraie cette fois,
qui est ici donnée.
Le cambrurier intervient lorsque la chaussure est si
usée qu'elle ne peut plus être revendue d'occasion par les chiffonniers ou les
brocanteurs.
Bulletin coopératif
Les ouvriers cambruriers
La Presse — 6 juin 1895
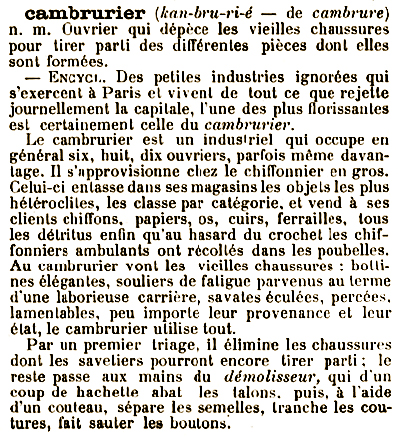 L'Union syndicale des ouvriers cambruriers de la Seine vient de tenir, salle
Jeanne-d'Arc, rue Dunois, 45, son assemblée générale.
L'Union syndicale des ouvriers cambruriers de la Seine vient de tenir, salle
Jeanne-d'Arc, rue Dunois, 45, son assemblée générale.
Un grand nombre d'ouvriers de la corporation se sont rendus à l'appel de M. Ratier, organisateur et secrétaire du syndicat.
Il s'agissait d'élaborer le programme des revendications qui vont être soumises aux patrons.
La chambre syndicale, reconstituée il y a à peine quatre mois, compte déjà plus de 150 membres étroitement unis et désireux de réagir contre l'indifférence qu'ils ont trop longtemps montrée.
Un des principaux desiderata a été présenté aux patrons. On leur demandait de payer la huitaine aux ouvriers qu'ils congédient sur-le-champ sans grief plausible, attendu que les cambruriers, étant représentés au conseil des prud'hommes, doivent être considérés comme ouvriers et non assimilés aux hommes de peine.
Le syndicat n'a pu obtenir satisfaction sur ce point ; mais les patrons y consentiront quand ils sauront que les ouvriers sont décidés à cesser le travail s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans leurs légitimes réclamations.
La profession de cambrurier est peu connue du public, car elle ne compte dans Paris et la Banlieue que 500 ouvriers dont la besogne consiste à déclouer les vieilles chaussures pour en tirer le cuir avec lequel certains manufacturiers confectionnent les chaussures à bon marché. Ce travail, assez pénible, est dérisoirement rémunéré. Les ouvriers les plus habiles ne reçoivent qu'un salaire de 4 fr. par jour.
C'est cette situation qu'ont tour à tour exposée MM. Ratier, Corties, Combet et Le Mahot, dans leurs éloquents discours, à la réunion qu'a présidée M. Antoine.
Vauthier-Bay.
Adresser toutes les lettres et communications à M. Vauthier-Bay, aux bureaux du journal, 12, rue du Croissant.
Ateliers, fabriques et petits métiers du XIIIe
- Le cabinet de lecture des chiffonniers par Charles Yriarte (1863)
- Maquignons et maquilleurs de chevaux (1867)
- Les chasseurs de cabots (1868)
- L’impresario des mendiants (1872)
- Fabrique d'asticots (1883)
- Cuir de Russie (1885)
- Fabrique de squelettes (1885)
- Coupeur de queues de chevaux (1888)
- Les petits métiers de Paris : ramasseurs de crottes à la Glacière (1890)
- La ramasseuse de crottes (1893)
- Le cuiseur de cadavres (1896)
- La profession de cambrurier (1901)
- Rue Cantagrel, des ateliers de nickelage... (1932)





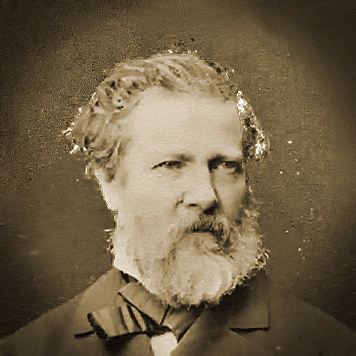 Eugène Oudiné, sculpteur et graveur en médailles, membre; de l'Académie des beaux-arts de Bruxelles, né le 1er janvier 1810, est décédé en avril 1887. Son nom était populaire car on pouvait lire sa signature sur toutes les pièces de monnaie frappées depuis 1870. Prix de Rome en 1851, il avait été élève de Gallé, de Petitot et d'lngres. Vers 1844, il fut attaché au Timbre et à la Monnaie. Ce qu'on connaît le plus de lui, ce sont les effigies des pièces de cent sous. Oudiné a pourtant exécuté bon nombre de statues.
Eugène Oudiné, sculpteur et graveur en médailles, membre; de l'Académie des beaux-arts de Bruxelles, né le 1er janvier 1810, est décédé en avril 1887. Son nom était populaire car on pouvait lire sa signature sur toutes les pièces de monnaie frappées depuis 1870. Prix de Rome en 1851, il avait été élève de Gallé, de Petitot et d'lngres. Vers 1844, il fut attaché au Timbre et à la Monnaie. Ce qu'on connaît le plus de lui, ce sont les effigies des pièces de cent sous. Oudiné a pourtant exécuté bon nombre de statues.