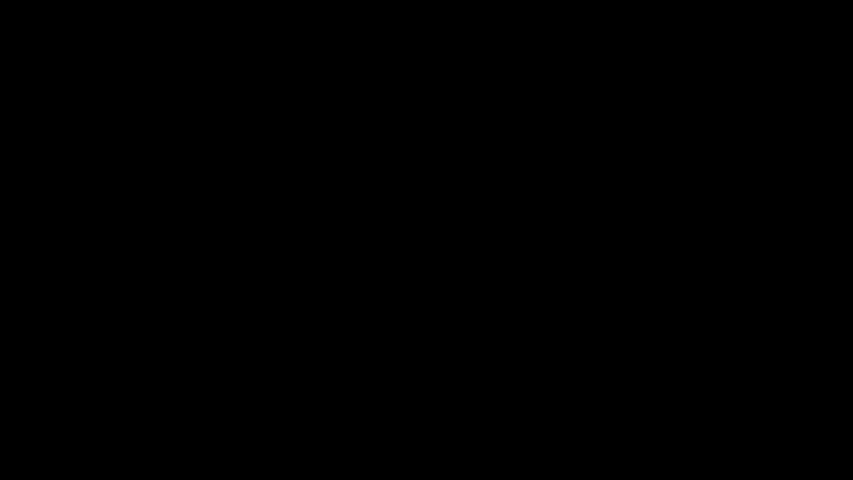Un syndicat d'indigents
Le Temps — 10 octobre 1897
La cour des Miracles était hier soir en grand émoi ; elle avait transporté cahin-caha, béquillant et gesticulant, ses pénates dans le quartier de la Gare, rue Nationale, tout là-bas, au bout de Paris, près de la barrière d'Italie. Il faut dire que le 13° arrondissement a un maire, M. Thomas, « qui fait des économies sur les fonds alloués par la Ville au service de bienfaisance, et qui, cette année, a rendu 50,000 francs à l'Assistance publique ».
Aussi les indigents du 13è ont-ils formé un syndicat. Ce sont eux qui avaient convoqué hier, dans la salle Deroche, leurs confrères de la besace, hypnotisés par ce chiffre de 50,000 francs, ces 50,000 fr. « qu'on leur avait volés ».
Les citoyens Paulin-Méry, député de l'arrondissement, Maihdert, premier adjoint, Navarre, conseiller municipal, se trouvaient dans la salle, au milieu de la foule grouillante des syndiqués.
Après l'exposé de la situation, le citoyen président Leignière donne la parole à l'adjoint, M. Maindert, pour s'expliquer. Mais l'adjoint démontre à l'assistance que, bien qu'il préside le bureau de bienfaisance de la mairie, il n'est nullement responsable de l'emploi de l'argent. C'est le maire seul, c'est M. Thomas qui a pleins pouvoirs. Et c'est bien pour cela que, quoique convoqué par lettre recommandée, il n'a pas osé venir à la réunion des indigents.
Des cris partent de tous côtés, des béquilles et des moignons se tendent en geste de haine, au seul nom de M. Thomas. Et c'est bien pis quand le député Paulin-Méry, d'une voix tonitruante, vient à son tour exhaler son mépris pour le maire du treizième arrondissement.
Au milieu d'un brouhaha, d'une fumée et d'une odeur nauséabonde, vers dix heures et demie, l'ordre du jour suivant a été voté à main levée :
« Les citoyens réunis salle Déroche, 118, rue Nationale, protestent contre le virement d'une somme d« plus de 50,000 francs fait au détriment des familles pauvres, invitent les élus, et en particulier les conseillers municipaux, à veiller à ce que pareil fait ne se renouvelle plus et demandent qu’une enquête sérieuse et complète soit faite sur l’administration des fonds de l'Assistance publique pendant ces dix dernières années. »
Il nous a paru intéressant de voir ce matin M. Thomas, maire de l'arrondissement, qui nous a fait au sujet de cette réunion les déclarations suivantes :
«Cette affaire est une pure manœuvre électorale ; je n'ai jamais été boulangiste, et, depuis plusieurs années, je suis en butte aux attaques de M. Paulin-Méry. Et, comme les élections approchent, mes adversaires ont imaginé la petite manifestation que vous savez. En ce qui concerne la réserve de 50,000 francs qui a été restituée à l'Assistance publique, je suis bien aise de pouvoir vous dire que je suis depuis bien longtemps rapporteur du bureau de bienfaisance, et que je me suis toujours élevé contre ces économies. Il faut remarquer aussi que cette somme de 50,000 francs ne représente pas la réserve faite cette année, mais une accumulation de plusieurs séries d'économies.
Depuis 1895, le régime de l'assistance a été modifié. Nous ne sommes plus autonomes; antérieurement, les réserves que nous faisions restaient dans notre caisse et étaient consacrées à l'exercice suivant. Mais, depuis deux ans, nous devons rendre des comptes à l'Assistance, et lui restituer les sommes que nous n'avons pas dépensées. Un de mes adjoints, qui est mort il y a six mois, avait, à mon insu, réalisé les économies qui, réunies, forment cette somme de 50,000 francs dont mes adversaires politiques se font une arme contre moi. Mais vous pouvez être certain que jamais aucune demande légitime de secours n'a été repoussée dans le 13e arrondissement.»
A lire également
Un syndicat des « rouspéteurs » vient de se créer à Paris (1927)