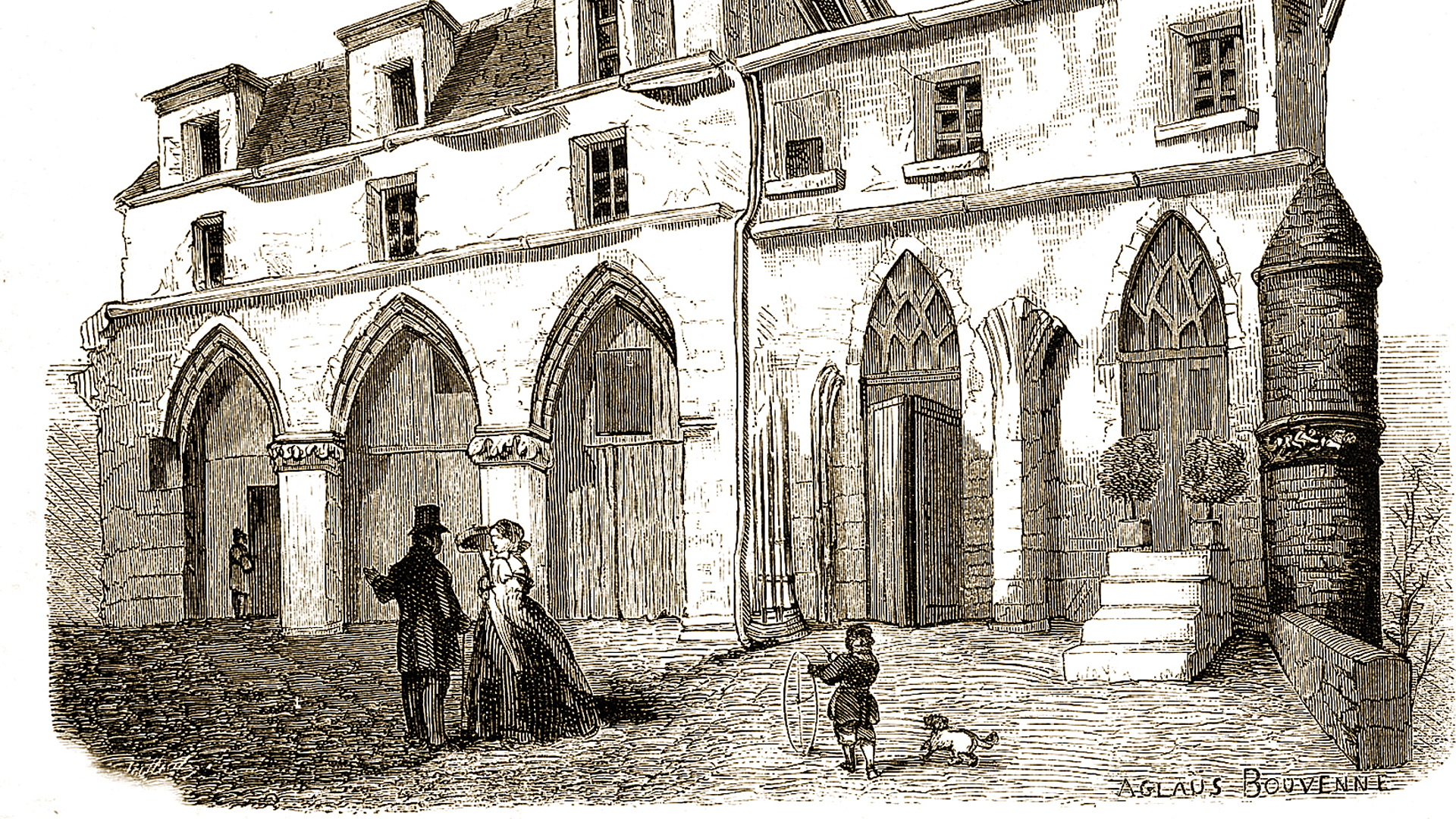La mort de M. Curie
Une Cérémonie fort simple. — A la Maison mortuaire. — Le Désespoir de Mme Curie. — Au Cimetière.
Le Petit Parisien — 22 avril 1906
Les obsèques de M. Curie ont été célébrées, hier, avec la plus grande simplicité et sans aucune cérémonie.
Il n'avait pas été envoyé de lettre de faire-part.
Seuls, les élèves et quelques amis personnels de l'illustre chimiste avaient été avisés par lettres manuscrites.
La levée du corps était fixée à trois heures et demie. Un fourgon des pompes funèbres devait venir prendre la dépouille du savant pour la transporter à Sceaux, où aurait lieu l'inhumation.
Dès trois heures arrivèrent à la maison mortuaire, 108, boulevard Kellermann, des professeurs de la Sorbonne et du Collège de France, ainsi que des membres de l'Institut. Tour à tour ils pénétraient dans la petite maison, mais en ressortaient presque aussitôt. MM. Appell, doyen de la faculté des sciences Cheneveau et Debierne, préparateurs de M. Pierre Curie, assistaient la malheureuse veuve.

Le cercueil, déposé dans la salle à manger transformée en chambre mortuaire, était recouvert d'un drap noir frangé de blanc et de la gerbe de fleurs envoyée par les anciens élevés de l'école de physique et de chimie.
Parmi les personnalités présentes, nous reconnaissons MM. Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique ; Poincaré, ministre des Finances, Gaston Doumergue, ministre du Commerce, le général Dessiner, gouverneur militaire de Paris, de Selves, préfet de la Seine Lépine, préfet de police, les professeurs Jeannet, Daguilhon, Moissan, Perrin, etc.
M. et Mme Loubet se sont fait inscrire, ainsi que M. et Mme de Soubeyran de Saint-Prix.
Le fourgon arrive, suivi de quatre voitures de deuil, et Mme Curie, dont le désespoir est vraiment tragique, se place devant la fenêtre par laquelle les employés des pompes funèbres font passer le cercueil.
— Allez doucement murmure la pauvre femme.
Elle monte dans la première voiture, en compagnie de son beau-père, le vénérable docteur Curie. Le funèbre cortège s'ébranle, respectueusement salué par l'assistance. M. Aristide Briand le suit dans son coupé. Au trot, on gagne la porte de Châtillon, par le boulevard Jourdan.
A la porte du cimetière attendaient le maire de Sceaux, M. Château, entouré de ses adjoints, MM. Fontaine et Chapsal, Philippon, commissaire de police, quelques personnalités du monde scientifique, une délégation de l'Association générale des étudiants et cinq étudiants portugais. Quand le fourgon funèbre est arrivé à la grille du cimetière, toutes les personnes présentes se sont découvertes et le cortège s'est acheminé lentement vers la tombe préparée. Le cercueil de M. Pierre Curie a été descendu ; on l'a placé par-dessus celui renfermant les restes de sa mère, et les fossoyeurs ont comblé la fosse béante.
Le matin, on avait exhumé, de la tombe où ils avaient été déposés, les restes de Mme Curie, née Sophie de Pouilly, mère de l'inventeur du radium, morte le 27 septembre 1897. Ils avaient été réunis dans un petit cercueil, pour être déposés à côté du corps de son fils.
A cinq heures, la funèbre cérémonie était terminée.
A lire également