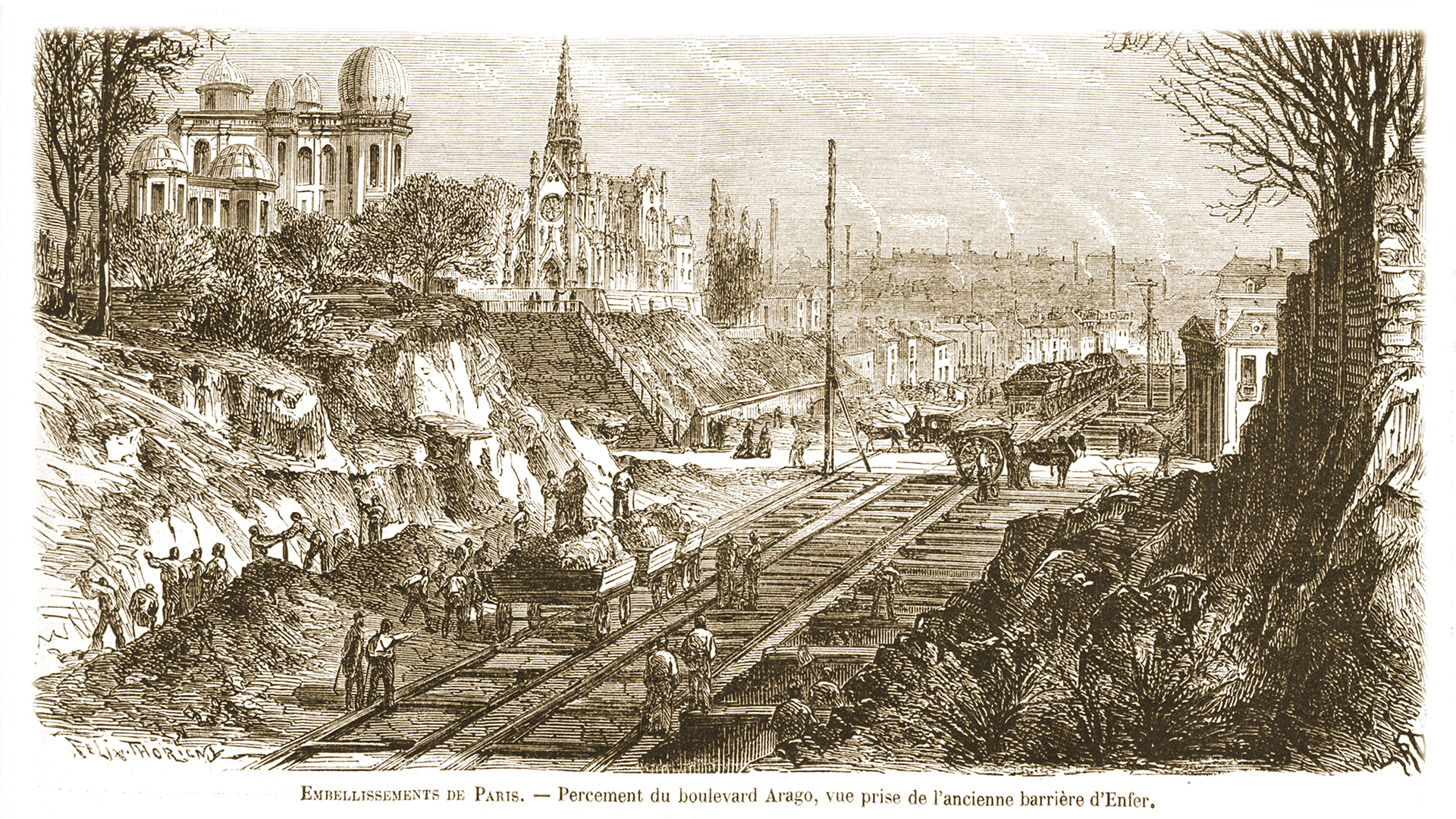Un travail cyclopéen (2)
Le Soleil — 24 août 1897
M. Arrault, l’ingénieur chargé d’achever les travaux du puits artésien de la Butte-aux-Cailles, a le droit d'être fier de son œuvre. Le 6 août courant, il a atteint la grande nappe liquide du sous-sol parisien, à une profondeur de 567 mètres. D’un seul bond, l'eau est montée à 547 mètres, soit à vingt mètres du sol. Depuis, de nouveaux coups de sonde ont été donnés, l’eau monte toujours, demain elle jaillira, claire, limpide et tiède.
Le voilà donc achevé, ce fameux puits artésien commencé en 1863, abandonné en 1865 et repris vingt-sept ans après, en 1892, à la suite d’un article du Soleil.
Cela nous fait, à l'heure actuelle, quatre puits artésiens à Paris, puisque nous avions déjà ceux de Grenelle, de Passy et de la Chapelle.
Toutefois, il est question de ne pas s’en tenir à la profondeur actuellement atteinte par le puits de la Butte-aux-Cailles. Voici pourquoi :
Les ingénieurs ont remarqué que chaque nouvelle prise d’eau sur la grande nappe souterraine avait pour résultat immédiat de faire diminuer le débit des puits artésiens déjà existants. Ce phénomène va fatalement se produire. Aussi, M. Arrault creuserait-il volontiers encore cinquante ou soixante mètres afin de dépasser la couche dite des sables verts, et d’atteindre la deuxième grande nappe, encore inexploitée, que de savants géologues soupçonnent exister dans le sous-sol parisien à une pro fondeur d’environ 620 à 650 mètres. On ne peut qu’encourager les ingénieurs à marcher dans cette voie, car la mise à exécution d’un pareil projet aurait de nombreux avantages.
D’abord, elle ne réduirait en rien le débit des puits existants, tout en permettant au puits artésien de la Butte-aux-Cailles de fournir une plus grande quantité d’eau. De plus, ce forage plus profond nous fournirait un liquide de deux ou trois degrés plus chaud, ce qui n’est pas à dédaigner puisqu'une partie de l’eau du puits de la Butte-aux-Cailles est destinée, dans l’esprit de l’édilité parisienne, à doter ce quartier ouvrier de piscines et bains gratuits, à eau chaude, en toute saison.
Ainsi se trouvera réalisé, du moins en partie, le rêve de M. le comte Alphonse de Calonne qui voudrait voir la ville pourvue de bains chauds gratuits, ainsi qu'il en existe à Budapest.
Ce sera toujours un commencement, en attendant que nous mettions en pratique les conseils de M. Berthelot qui voudrait nous voir aller chercher dans les entrailles de la terre de l'eau à 100 degrés, c’est-à-dire de la chaleur, source de toute énergie. N’allez pas croire que cela soit impossible. Il suffirait, pour obtenir ce résultat, de forer un puits de trois kilomètres ; or, il existe un précédent. On a fait à Paruschowitz, en Silésie, un sondage à deux mille mètres de profondeur. Nos savants ingénieurs sauraient bien, si la chose leur était demandée, atteindre mille mètres de plus.
Mais c’est la du rêve, du moins pour aujourd’hui. La réalité est assez belle pour que nous nous en contentions.
Disons en terminant comment s’obtient la force ascensionnelle de l’eau dans les puits artésiens, renseignement qui nous a été demandé jadis.
Il serait erroné de croire que les nappes liquides du sous-sol sont stagnantes et immobiles ; il existe, au contraire, de véritables courants souterrains, formés par l’infiltration des eaux de pluie à travers les couches de sable qu'elles délayent et en traînent avec elles. Il se produit ce phénomène que des canaux, partis d’un niveau supérieur, viennent s’enfermer entre deux couches imperméables ; il suffit alors de forer à travers ces couches, pour que l’eau jaillisse à une hauteur proportionnée à celle du point de départ du courant sou terrain. On voit que c'est une simple appli cation des lois de l'équilibre.
Pour en revenir à notre puits artésien de la Butte-aux-Cailles, disons que, grâce à notre insistance, les habitants du treizième arrondissement vont avoir l'eau chaude en abondance, pour le plus grand bien de l’hygiène publique. Le Soleil est heureux et lier d’avoir contribué à l’amélioration du sort d'un quartier vraiment déshérité.
H. Grenet
Sur le puits artésien de la Butte-aux-Cailles
Les travaux de creusement du puits artésien de la Butte-aux-Cailles durèrent globalement près de 40 ans dont 20 durant lesquels ils furent totalement à l'arrêt. Les travaux proprement dits commencèrent en avril 1863 et rencontrèrent de multiples difficultés qui ne permirent pas d'avancer significativement. La Commune de Paris n'épargna pas le puits et les communards incendièrent les installations. Après la Commune, les travaux reprirent mais s'interrompirent dès 1872 ou 1873 faute pour la ville de trouver un accord financier avec l'entrepreneur pour les travaux restant à accomplir mais aussi dans l'attente des résultats définitifs du creusement d'un autre puits artésien, place Hébert.
Première époque (1863-1872)
- Des nouvelle du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Siècle - 26 avril 1864)
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Siècle - 27 aout 1865)
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Journal des débats politiques et littéraires ― 18 septembre 1868)
Deuxième époque : le puits oublié (1872-1892)
Une fois les travaux interrompu, le puits artésien de la Butte-aux-Cailles tombe dans l'oubli.
Il faut dire que sa nécessité n'est plus évidente. Paris avait fait face à ses besoins en eaux et l'idée de base du
puits, avoir un jaillissement d'eau en un point haut de la capitale, n'est plus la seule réponse aux problèmes d'alimentation
en eau.
En 1889, le journal Le Figaro pose la question du devenir du puits sans susciter d'écho. En janvier 1892, c'est
le quotidien le Soleil, sous la signature de Marcel Briard, qui pose à nouveau la question mais cette fois,
une réaction semble s'enclencher.
Ernest Rousselle, conseiller municipal du quartier Maison-Blanche, se saisit de l'affaire et finallement, en juillet
1892, le préfet de la Seine décide de relancer les travaux et présente au conseil municipal de Paris un mémoire tendant
à la reprise des travaux interrompus depuis près de 20 ans.
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Figaro - 12 septembre 1889)
- Le puits de la Butte aux Cailles (Le Soleil - 8 janvier 1892)
Troisième époque : reprise des travaux et l'inauguration du puits (1893-1904)
Les travaux reprirent donc début 1893 et dans les premiers jours d'août 1897, l'eau tant recherchée,
enfin, jaillit. Cependant, l'histoire n'était pas terminée car ce n'est pas encore la nappe d'eau visée par les géologues
qui a été atteinte. Il faut encore creuser. La presse se montre de plus en plus critique ou sacarstique à l'égard du
chantier car il est clair que le puits artésien, 35 ans après son lancement, ne répond plus à aucune nécessité. Tout
au plus, sont évoqués un usage pour améliorer le flux des égouts voire l'idée d'une piscine gratuite pour les habitants
du quartier.
Le 16 septembre 1898, la nappe recherchée est atteinte. Les espoirs sont vite déçus, le débit s'avère faible mais suffisant
pour la piscine projetée. En attendant, l'eau, à 28°, s'écoulait dans une vasque à disposition des parisiens à raison
de 600 litres à la minute avant d'aller se perdre dans les égouts. Le puisatier mourut. Deux ans après, sous la direction
du fils du puisatier, on se remit à creuser. Le 19 novembre 1903, une nouvelle nappe était atteinte à la cote 582,40
mètres. Cette fois, on décida d'arrêter les frais. L'inauguration officielle du puits eu lieu le jeudi 7 avril 1904
à 2 heures.
- Reprise des travaux à la Butte-aux-Cailles (Le Soleil - 19 janvier 1893)
- Un travail cyclopéen (Le Soleil - 27 janvier 1896)
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Temps - 11 août 1897)
- Un travail cyclopéen (2) (Le Soleil - 24 août 1897)
- 1898, les travaux ne sont toujours pas terminés (Le Monde illustré – 1er octobre 1898)
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Parisien - 22 octobre 1898)
- Pour prendre un bain (Le Temps - 24 juillet 1901)
- Un puits artésien (Le Français — 24 septembre 1902)
- Les eaux thermales de la Butte-aux-Cailles. (La Presse — 23 novembre 1903)
- Le puits artésien de la Butte aux Cailles (Le Petit-Journal - 22 décembre 1903)
- Inauguration - Discours de M. de Pontich, directeur administratif des Travaux de Paris, représentant le préfet de la Seine
- Inauguration - Discours de M. Henri Rousselle, conseiller municipal du quartier de la Maison-Blanche
- A propos de l'inauguration du puits artésien de la Butte-aux-Cailles (Le Voleur — 24 avril 1904)