Le groupe scolaire de la rue Kuss
Beaux-arts — 21 décembre 1934
Rue Kuss, dans le XIIIe arrondissement, la Ville de Paris vient de faire construire un groupe scolaire qui est le complément indispensable des immeubles à loyers modéré habitations à bon marché édifiées en même temps dans le quartier.

M. Roger Expert, architecte D.P.L.G., qui a été chargé d’établir le projet de ce groupe, a réalisé un type intéressant d’école urbaine : l’école à gradins.
Le parti adopté par l’architecte a été déterminé par la disposition du terrain mis à sa disposition qui apparaissait comme peu propre à l’implantation d’une école. Ce terrain en forme de trapèze, s’étendait très en profondeur avec une étroite façade sur la rue ; l’orientation imposait la direction générale nord-sud avec exposition à l’est et à l’ouest. L’architecte a dû s’adapter à ce terrain ingrat dont le niveau dépassait de 5 ou 6 mètres celui de la rue. C’est afin d’éviter des frais de terrassement sérieux que les divers bâtiments du groupe et leurs cours respectives ont été établis à des niveaux différents. Le profil du terrain a été un facteur important de la composition : cette construction est en somme le résultat d'un problème de position.
Le bâtiment principal, qui s'allonge dans le sens de la profondeur, a été reporté sur la gauche et constitue un écran protecteur des vents d’ouest. Il s’achève en façade par une série de gradins en arrondi qui permettent d'atteindre en hauteur un gabarit que les proportions modestes de la rue Kuss n'auraient pu autoriser autrement. Les retraits successifs de cet immense « paravent » offrent l’avantage i d’ouvrir les cours avec modération à l’arrivée de l’air.
La façade, en quelque sorte, fend l'air et forme proue. Dans ce vaisseau de béton armé, les enfants s’embarquent pour la croisière scolaire, leur première croisière, celle qui doit les préparer à la grande croisière de la vie. Les passagers ont de trois à douze ans. À l’intérieur, tout a été créé à leur convenance, afin qu’ils conservent un lumineux souvenir de leur grand voyage à travers le monde des études, lequel doit s’effectuer dans la joie.

Dès le départ, chaque école étant parfaitement indépendante des autres, garçons et filles sont séparés. La loge est en vigie. L’entrée des garçons a lieu à bâbord, celle des filles, de la « Maternelle », à tribord. De ce côté, par le vestibule, on pénètre directement chez les petits. Cour et préau sont au rez-de-chaussée : pas d’effort à faire pour monter ; ils sont orientés au midi. Ce sont les appartements de 1ère classe ; les plus petits sont les plus choyés. Mille détails ingénieux embellissent leur domaine : c’est l’aménagement de la cour avec ses bancs en ciments, très larges et très bas qui sont à la fois tables et bancs, et ses grands arceaux de ciment armé où s’enroulent des plantes grimpantes ; c’est dans le préau, dont les murs forment murs de soutènement, sont composés d’éléments incurvés, une décoration de fresques qui dévoile à leurs yeux innocents le mystère des Saisons. Une salle de repos, des salles de propreté, un isoloir pour l’enfant subitement malade, une terrasse pour les bains de soleil complètent les quatre salles de classes aux larges baies vitrées de la Maternelle.
La cour de l’école des filles se trouve sur le premier gradin, c’est-à-dire à 5,60 m au dessus de la rue, niveau du sol conservé. C’est le pont supérieur ; il est abrité des vents contraires par le bâtiment principal haut de 23 m 80, lequel renferme les dix salles de classe de cette école. On y accède par un escalier particulier qui prend naissance dans le vestibule du bas. Le préau est ouvert largement. Dans l’école des filles, on apprend à lire et à compter, mais aussi à laver, à repasser et à coudre : des salles ont été aménagées à cet effet au troisième étage du bâtiment. On apprend encore à respirer et à faire de la gymnastique sur le vaste solarium aménagé sur le toit où flotte, au haut d’un mât, le pavillon.

L’école des garçons occupe l’extrémité du terrain. On y accède par une cour de service qui fait suite au vestibule d’entrée affecté aux garçons. Cette cour sur laquelle donne le service médical, le service des douches, le réfectoire et les cuisines, mène à un escalier desservant le préau. Préau et cour de récréation s’harmonisent à ceux de l’école des filles et leur font suite. Les dix classes que comporte l’école des garçons sont réparties entre le bâtiment principal et l’aile en retour qui forme le fond du groupe scolaire. Le toit en terrasse de ce bâtiment est réservé aux exercices de culture physique. Un atelier à bois et un atelier pour le fer ont été joints aux salles de classes.

Quoiqu’il paraisse, l’architecture, ici, ne dit que ce qu’elle a à dire, les volumes apparents ne sont que l’enveloppe des surfaces intérieures. Ainsi les redans, sur le plan circulaire de la façade, qui renferment les appartements de l’instituteur et des institutrices des trois écoles sont de véritables postes de commandement orientés en tous sens. L’architecture, qui se doit de jouer un rôle éducatif à l’école, n’est point là indifférente. Par son aspect le groupe scolaire de la rue Kuss est appelé à frapper l’esprit des enfants, l’atmosphère de vie et de lumière que l’on a su y créer est la plus favorable qui soit à l’épanouissement de l’enfance.
S. Gille-Delafon.
Le groupe scolaire de la rue Kuss
La rue Kuss
C'est en 1885 que le conseil municipal de Paris proposa de donner le nom de Kuss, dernier maire français de Strasbourg en 1870, à la voie nouvelle à ouvrir entre la rue du Pot au Lait (qui allait devenir plus tard la rue Brillat-Savarin) et la rue Damesme. L'intérêt de cette nouvelle voie était de relier les quartiers sud-ouest de la Maison-Blanche à l'avenue d'Italie mais sa réalisation posait une difficulté particulière : le franchissement de la vallée de la Bièvre et de la rue des Peupliers. En effet, sur une très courte distance, la rue commençait à l'embranchement de l'ancienne rue de la Fontaine aux Clercs à une altitude d'environ 48 mètres, devait descendre à 37,78 mètres au niveau de la rue des Peupliers pour remonter à 51,18 m au niveau de la rue Damesme.
La tâche était donc compliquée et prit du temps. En 1923, le percement de la rue Kuss était toujours au nombre de travaux prioritaires à accomplir selon une liste établie par Adolphe Chérioux, conseiller municipal du quartier Saint-Lambert en charge de l'urbanisme à l'Hôtel de Ville.
Ce sera finalement en 1929 que le percement de la rue sera achevé au moins dans sa première partie car la jonction avec la rue Damesme reste à faire. Le quotidien Paris-Soir y emmènera deux fois ses lecteurs et y reviendra en 1930 sous la plus d'Elie Richard, auteur de la tournée.
La rue Kuss n'ira pas plus loin. En 1931, c'est le nom de "Docteur Tuffier" que l'on donne au tronçon restant à ouvrir en direction de la rue Damesme. Il sera ouvert en 1934.
Les écoles
Après la Grande Guerre, les jardins maraichers existants entre la place de Rungis et la rue des Peupliers commencent à céder la place à des groupes d'habitations à bon marché. Avec les constructions des années 2O dues aux initiatives privées et publiques rue de la Fontaine à Mullard et rue Brillat Savarin, le secteur se peuple et il faut répondre aux besoins de cette nouvelle population. En 1931, Louis Gelis (1886-1940), le très actif député et conseiller municipal du 13e, réclame l'ouverture d'une école ce nouveau quartier (et aussi d'un lycée pour le 13e qui en est dépourvu). Ce sera l'école de la rue Kuss.
- Construction d'un groupe scolaire rue Küss (1931)
- Inauguration du groupe scolaire de la rue Kuss (Le Matin - 30 septembre 1934)
- Le groupe scolaire de la rue Kuss (Beaux-arts - décembre 1934)
Le nouveau groupe scolaire était présenté comme le plus moderne de Paris. C'était certainement vrai mais on n'ignorait pas que sa localisation présentait certains inconvénients dont la proximité du chemin de ceinture n'était pas le principal. Au delà des rails, à une centaine de mètres, l'usine Gnome et Rhône tourne à plein régime, c'est le cas de le dire, puisqu'une dizaine de bancs d'essai de moteur d'avion y sont en fonctionnement et "font un bruit effroyable incommodant les habitants de tout le quartier" (Le Populaire, 29 juin 1933). Néanmoins, on en est très fier.





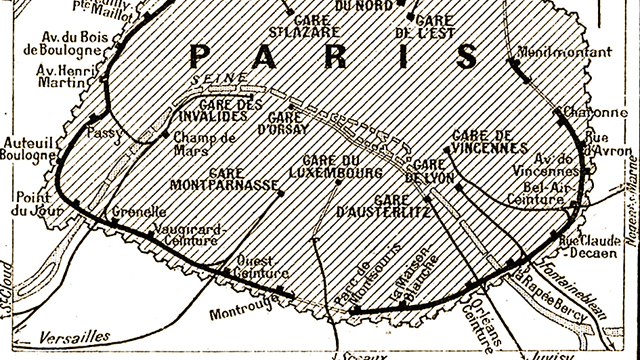



 Jacques Daviel (1696-1762) fut un célèbre oculiste. Il fut le premier à réussir une opération de la cataracte et a été chirurgien du roi Louis XV.
Jacques Daviel (1696-1762) fut un célèbre oculiste. Il fut le premier à réussir une opération de la cataracte et a été chirurgien du roi Louis XV.