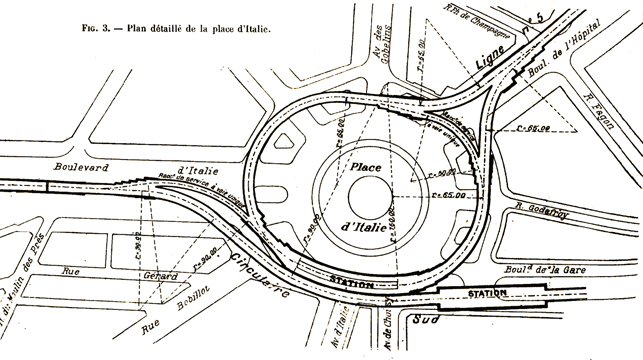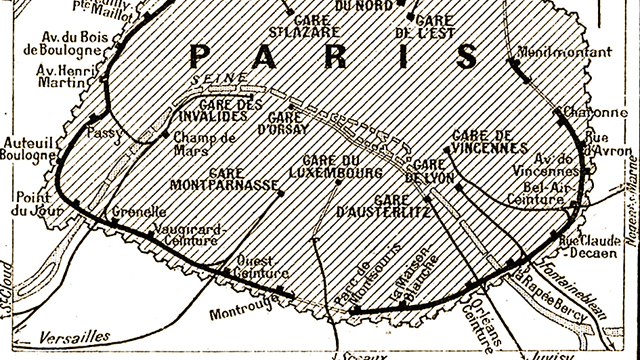La bergère d’Ivry
Le Rappel — 22 juin 1891
Elle est déjà si ancienne cette dramatique histoire de la bergère d'Ivry qui passionna tant nos pères, que bien peu de la génération actuelle la connaissent plus que vaguement. Nous croyons donc être agréable à nos lecteurs d'Ivry qui assisteront à la cavalcade d'aujourd'hui, en la relatant ici.
C'est un simple drame d'amour ou plutôt un simple crime passionnel commis par une jeune brute.
Si Aimée Millot avait voulu aimer François Ulbach, ce délaissé de la fortune, ce paria dès le jeune âge serait peut-être devenu bon.
Dès leur première rencontre — c'était vers la fin de 1827 — il la remarqua ; il était alors garçon dans une guinguette de la barrière de Fontainebleau à l'enseigne des « Nouveaux deux moulins » ; elle était au service d'une veuve, Mme Détrouville, et portait tous les dimanches chez M. Ory, l'hôte des Nouveaux deux moulins, du beurre et du lait.
Ulbach était presque un enfant trouvé, il n'avait jamais connu sa mère, et les parents éloignés qui l'avaient recueilli n'avaient pas tardé à le jeter sur le pavé de Paris.
Admis d’abord à l'hospice d'orphelins de la rue Saint-Antoine, il fut, après sa sortie, ramassé par une ronde de police, alors qu'il dormait sous un banc, et envoyé pour vagabondage dans une maison de correction.
Après quinze mois de détention à Poissy et à Sainte-Pélagie, il chercha à gagner honnêtement sa vie et trouva à se placer chez M. Ory.
Aimée Millot était une brave jeune fille bien modeste et bien sage que tout le monde connaissait et aimait à Ivry et qu'on avait surnommée la Bergère d'Ivry parce que tous les jours on la voyait sous les ormes du boulevard, un livre à la main, coiffée d'un grand chapeau de paille, gardant les chèvres de sa patronne.
Ulbach, qui n'avait jamais aimé et qui n'avait jamais été aimé, se sentit tout de suite attiré vers la jeune fille et il lui parla mariage.
Elle sembla l'écouter, mais un jour il la vit au bras d'un élégant jeune homme, et il en conçut une vive jalousie. Presque à la même époque Mme Détrouville, qui avait eu vent des relations d'Ulbach et d'Aimée Millot, défendit à celle-ci de fréquenter le garçon marchand de vin qu'elle ne supposait susceptible d'aucun sentiment honnête.
Aimée en informa Ulbach. On peut se douter du désespoir du pauvre garçon, surtout quand il sut que le jeune homme vu au bras d Aimée était son cousin germain et que Mme Détrouville rêvait de les marier ensemble.
Ulbach perdit la tête ; ses excentricités le firent congédier par M. Ory, et il se réfugia rue des Lyonnais chez deux vauriens, ses camarades de la maison centrale.
Il y resta trois jours, puis un matin — le 25 mai 1828 — il s'en fut rue Descartes, en face l'École polytechnique, acheta chez un brocanteur un énorme couteau, se rendit ensuite à la préfecture de police pour y retirer son livret, et, l'après-midi venue, se dirigea du côté d'Ivry.
Il trouva Aimée Millot gardant ses chèvres, en compagnie d'une fillette de huit ans, Julienne Saumon.
Il lui demanda des explications, qu'elle refusa ; il la supplia de l'aimer, lui promettant le mariage ; elle le repoussa. Alors, furieux, il la frappa de cinq coups de couteau, dont l'un, le dernier, s'enfonça entre les deux épaules de la pauvre Aimée.
Puis il s'enfuit.
Julienne, qui s'était sauvée en criant, fit le récit du crime, et pendant huit jours on rechercha inutilement le meurtrier.
II vint, poussé par le remords, se livrer lui-même à M. Roger, commissaire de police du marché aux chevaux.
Devant la cour d'assises, il affecta de n'éprouver aucun regret de l'acte qu'il avait commis.
Il fut condamné à mort.
Il monta sans faiblesse sur l'échafaud élevé en place de Grève.
De pieuses personnes perpétuèrent le souvenir d'Aimée Millot en élevant un modeste monument à l'endroit même où elle avait été tuée.
La Bergère d'Ivry
Les faits rapportés par la presse
Le procès d'Honoré Ulbach - 27 juillet 1827
- Accusation d'assassinat contre le sieur Ulbach. - Le Constitutionnel du 11 juillet 1827 reproduisant la Gazette des Tribunaux
- L'acte d'accusation- Journal des débats politiques et littéraires - 27 juillet 1827
- Le procès d'Honoré Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 28 juillet 1827
- Le procès d'Honoré Ulbach - Le Constitutionnel - 28 juillet 1827
- Ulbach se pourvoit finalement en cassation - Le Constitutionnel - 30 juillet 1827
L'exécution d'Honoré Ulbach
- Exécution d'Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 11 septembre 1827
- Les derniers moments d’Ulbach - La Quotidienne du 12 septembre 1827 reproduisant La Gazette des Tribunaux
Récits d'historiens et autres auteurs
- Alfred Delvau : Barrière Croulebarbe (1865)
- Revue des Théâtres : "La Bergère d'Ivry" - Le Siècle du 9 juillet 1866
- Les exécutions en place de Grève : Ulbach (La Lanterne - 1890)
- Le Rappel : La bergère d'Ivry (A propos de la cavalcade du Petit-Ivry - 1891)
- Georges Cain : Le long de la Bièvre (1905)
- Martial de Pradel de Lamase : Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)
- Martial de Pradel de Lamase : Le champ de l'Alouette (1933)