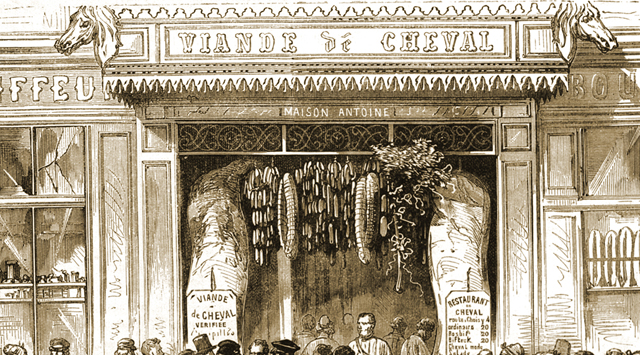COUR D'ASSISES DE LA SEINE.
Assassinat de la Bergère d’Ivry
Journal des débats politiques et littéraires — 28 juillet 1827
L'affreux évènement qui a répandu la consternation dans le quartier des Gobelins, sera soumis demain vendredi 27 au jugement du jury. Nous avons attendu l'époque de l'ouverture des débats pour faire connaitre les principaux faits de la procédure et de l'acte d'accusation dressé contre Jean-François Ulbach, inculpé de ce crime.
Ulbach est âgé de 26 ans ; il perdit sa mère à l'âge de douze ans. Il passa quelque temps à l'hospice des Orphelins, rue Saint-Antoine, en 1822, et fut plus tard condamné, comme vagabond, à rester pendant dix-huit mois dans une maison de correction. Il était, au moment du crime, au service du sieur Aury, marchand de vin traiteur aux Nouveaux-Deux-Moulins. C'est là qu'il avait eu occasion de connaître une jeune fille d'environ dix-neuf ans, qui était domestique chez la veuve Detrouville, rentière, demeurant avenue et commune d'Ivry, n° 10. Cette fille, nommée Aimée Millot, venait plusieurs fois par semaine apporter des œufs chez le sieur Aury, et gardait habituellement des chèvres sur le boulevard extérieur, du côté de sa maison. Ulbach avait conçu pour elle une passion violente, et ils avaient de fréquentes entrevues.
Mais, au mois de janvier dernier, la veuve Detrouville, s'étant aperçue cette intrigue, avait fait des représentations à la jeune Millot, en lui signifiant qu'elle ne la garderait pas chez elle si elle continuait à fréquenter Ulbach. La fille Millot avait promis de rompre avec lui, et même s'était engagée à rendre plusieurs cadeaux de peu de valeur qu'elle en avait reçus. Elle exécuta sa promesse en déclarant à Ulbach qu'il fallait absolument cesser de se voir.
Ulbach ne voulut rien recevoir, et, loin de le refroidir, la déclaration de la jeune Millot ne fit qu'exciter sa jalousie. Son caractère devint triste et sombre ; il négligeait son service ; tout ce qui avait trait à des affaires criminelles et particulièrement à des assassinats lui causait une vive impression ; il lisait avec avidité les écrits et les journaux où il pouvait trouver des détails sur les différents crimes, dont la connaissance était déférée aux tribunaux. Son agitation, après ces lectures, était extrême, et plusieurs fois il lui arriva de dire à Herbelin, son camarade : « C'est un grand malheur ; on ne sait pas ce que Dieu nous garde ; je crois que je finirai sur l'échafaud. » Puis, avec la contenance et le ton des crieurs publics, il prononçait lui-même son arrêt de mort. À d'aussi noirs pressentiments succédaient parfois aussi les accès d'une gaîté extraordinaire ; mais bientôt Ulbach redevenait sombre, taciturne, et versait des larmes en abondance.
Le vendredi 25 mai dernier, Aimée Millot fut envoyée par sa maîtresse, vers trois heures après midi, chez une grainetière, avenue d'Ivry, n° 7. Ulbach l'aborda, l'air hagard, la figure décomposée. Aimée Millot lui dit qu'elle ne pouvait lui parler. Elle se rendit au boulevard des Gobelins, où l'avait devancée la nommée Julienne Saumon, qui souvent gardait les chèvres avec elle. Bientôt après, toutes deux furent abordées, à peu de distance de la rue Croulebarbe, par Ulbach, qui lia conversation avec la fille Millot, et chemina avec elle jusque dans cette rue. Julienne Saumon, voyant alors qu'un orage allait éclater et entendant gronder le tonnerre, appela la fille Millot, et l'engagea à rentrer au logis. Elle ne s'en ira pas, dit alors Ulbach, et au même instant il lui asséna plusieurs coups de poing dans le dos, et la renversa par terre ; puis, tirant de sa poche un couteau, il lui en porta plusieurs coups. La jeune Saumon, témoin de cet attentat, ne put que crier : À la garde ! Elle vit Ulbach ramasser son chapeau et prendre la fuite ; elle s'approcha ; et l'infortunée Millot ne put lui dire que ces paroles : Ma petite Julienne, je suis morte ; va chercher Madame.
Le couteau qui avait servi d'instrument au crime fut trouvé dans une blessure faite au bas de l'épaule gauche ; il y était resté enfoncé jusqu'au manche. La malheureuse victime expira au bout d'une heure. L'autopsie du cadavre fit connaître que la mort avait été occasionnée par trois blessures qui, traversant la poitrine, avaient lésé les poumons. Ulbach se rendit chez la femme Champenois, marchande de mottes, rue des Lyonnais. Il arriva pâle, défait, tout trempé par la pluie qui tombait par torrents ; il dit qu'il venait de la barrière du Maine, et qu'il avait tant couru qu'il en avait un point de côté. Les deux fils de cette femme et un troisième individu se trouvaient là. « Si on te donnait, dit Ulbach à l'un d'eux, un coup de couteau entre les épaules, crois-tu que cela te ferait mourir ? » Bergeron lui répondit affirmativement, et lui demanda s'il avait l'intention de faire un mauvais coup » Ulbach eut l'air de sourire, et s'éloigna.
Il écrivit une lettre à la fille Millot, dans laquelle il mit un anneau qui lui venait d'elle ; puis, ayant cacheté cette lettre avec de la cire noire, il fut lui-même la mettre à la poste, Cette lettre, qui fait pièce au procès, est ainsi conçue :
« Mademoiselle, je vous envoie ces deux mots pour vous remettre l'anneau que vous m'avez demandé dans la lettre précédente. Je vous l'envoie ; mais c'est après vous avoir donné la mort. Je n'ai qu'un regret, c'est de vous avoir manquée. Adieu perfide, l'échafaud m'attend ; mais je meurs content de t'avoir punie de ton crime.
Tout a toi.
ULBACH
Mort, haine et vengeance !!! »
Ulbach écrivit ensuite à la femme Champenois qu'il s'était rendu coupable du plus grand des crimes, qu'il avait assassiné une fille aussi innocente qu’il était criminel, qu'une jalousie féroce l'avait porté à commettre ce forfait, et qu'il l'expiait par ses remords.
Le sur lendemain, 27 mai, Ulbach écrivit aussi à la veuve Detrouville une lettre ainsi conçue :
« Madame, c'est à vous que je dois l'excès où je me suis livré ; oui, c'est à vous à qui je dois la perte d'une épouse toujours chérie à mon cœur. Plusieurs fois ces mots s'étaient échappés de notre bouche, et nous étions heureux ; mais vous, femme acariâtre, vous seule vous mettiez entrave à notre félicité. Ce fer vous était réservé ; mais songez que vous ne l'échapperez pas, si vous ne faites ce que je vous prescris. Puisque je ne puis rendre les derniers devoirs à mon épouse, faites-le pour moi. Songez bien de faire ce que je vous prescris de faire. Je vous envoie cinq francs ; rendez-vous de suite à l'église d'Ivry, et faites-lui dire une messe en l'honneur de ses malheurs et des miens. Je demande vos égards : car je suis plus à plaindre qu’à blâmer. Toutes vos recherches seront infructueuses. Le moment où vous recevrez cette lettre, je serai pour jamais englouti dans le néant. Signé ULBACH.
P. S. Que cette lettre reste secrète entre vous et moi. Voilà la seule grâce que je vous demande. Le remords me déchire, je ne peux vivre davantage sans crime.».
On procédait aux recherches les plus actives pour découvrir la retraite d'Ulbach, lorsque le 3 juin un jeune homme se présenta chez M. Roger, commissaire de police au Marché aux Chevaux. Il avait l'air égaré, et d'une voix entrecoupée il demanda des renseignements sur l'assassinat de la jeune bergère. Comme on lui demandait quels étaient ses motifs pour faire de pareilles questions, il ajouta : C'est que c'est moi qui suis l'auteur de cet assassinat ! Il ajouta qu'il avait acheté le couteau chez un ferrailleur, rue Descartes ; qu'il ne s'était pas caché après le crime ; que le jour il errait de côté et d'autre, et la nuit couchait dans les maisons garnies près le Palais-Royal. « J'ai lu, dit-il ensuite, dans un journal, qu'un jeune homme avait été arrêté. Je ne veux pas avoir à me reprocher la mort ignominieuse d'un innocent. Cela l'emporte sur l'instinct de ma conservation, et pour garantir celui-là du sort dont il est menacé, je suis venu me livrer entre vos mains. »
Ulbach a depuis réitéré ses aveux dans l'instruction ; il a déclaré qu'il avait eu également des projets d'homicide sur la veuve Detrouville, et qu'il regrettait de ne les avoir pas mis à exécution, parce que c'était elle qui avait exigé de la fille Millot de ne plus le voir. M. le conseiller Hardouin présidera la Cour d'assises. M. de Broé, avocat-général, remplira les fonctions du ministère public. La défense de l'accuse est confiée à Me Charles Duez.
La Bergère d'Ivry
Les faits rapportés par la presse
Le procès d'Honoré Ulbach - 27 juillet 1827
- Accusation d'assassinat contre le sieur Ulbach. - Le Constitutionnel du 11 juillet 1827 reproduisant la Gazette des Tribunaux
- L'acte d'accusation- Journal des débats politiques et littéraires - 27 juillet 1827
- Le procès d'Honoré Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 28 juillet 1827
- Le procès d'Honoré Ulbach - Le Constitutionnel - 28 juillet 1827
- Ulbach se pourvoit finalement en cassation - Le Constitutionnel - 30 juillet 1827
L'exécution d'Honoré Ulbach
- Exécution d'Ulbach - Journal des débats politiques et littéraires - 11 septembre 1827
- Les derniers moments d’Ulbach - La Quotidienne du 12 septembre 1827 reproduisant La Gazette des Tribunaux
Récits d'historiens et autres auteurs
- Alfred Delvau : Barrière Croulebarbe (1865)
- Revue des Théâtres : "La Bergère d'Ivry" - Le Siècle du 9 juillet 1866
- Les exécutions en place de Grève : Ulbach (La Lanterne - 1890)
- Le Rappel : La bergère d'Ivry (A propos de la cavalcade du Petit-Ivry - 1891)
- Georges Cain : Le long de la Bièvre (1905)
- Martial de Pradel de Lamase : Un rendez-vous de chasse du Vieux Paris (1906)
- Martial de Pradel de Lamase : Le champ de l'Alouette (1933)