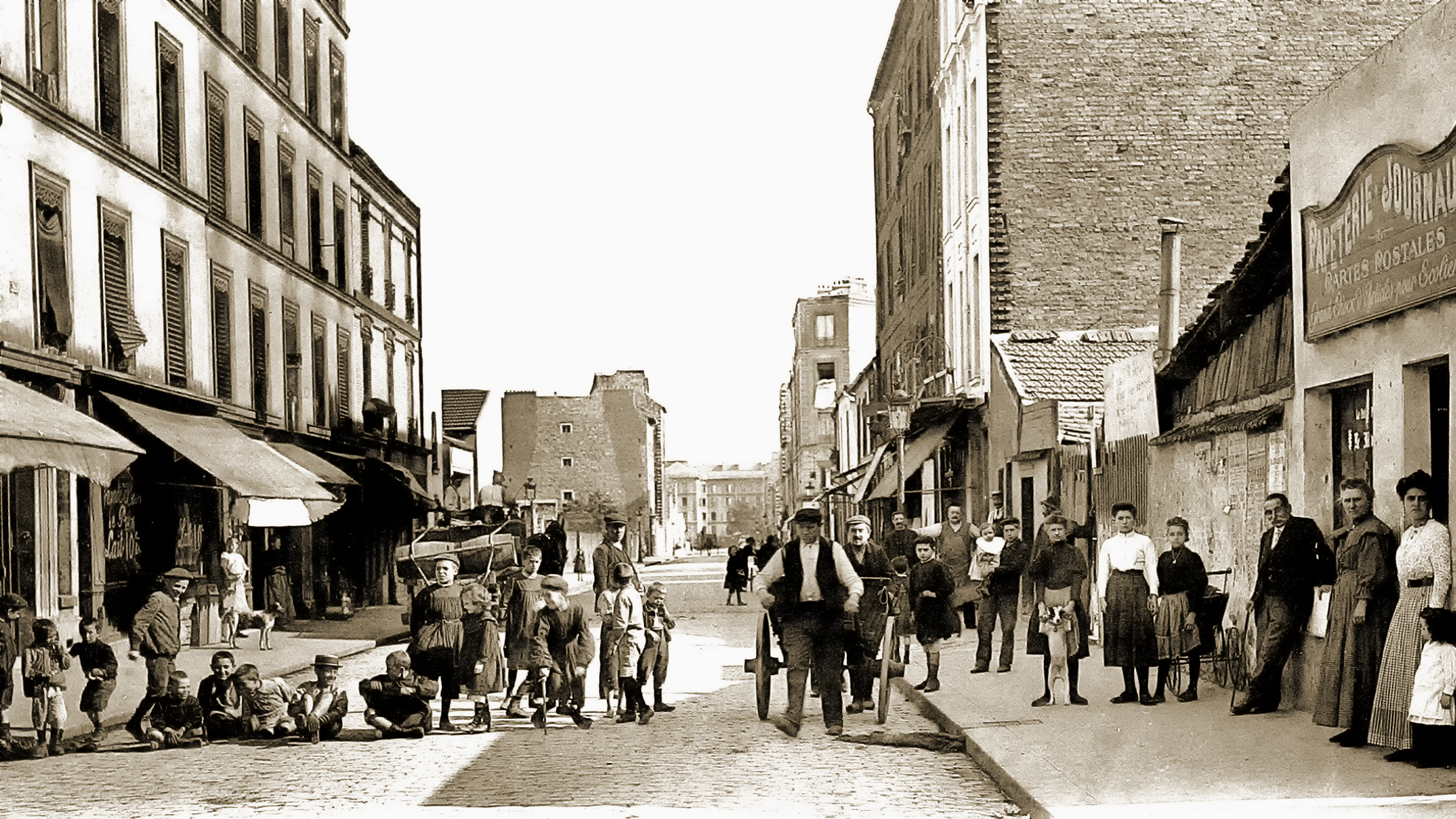L’ambulance mobile de la Maison-Blanche
Cette Ambulance placée du 23 septembre au 1er décembre sous la direction du docteur Andrieux, puis sous celle du docteur Bocquillon, était installée à la gare de la Maison-Blanche, chemin de fer de ceinture ; elle était composée de cinq escouades, à la tête de chacune desquelles se trouvait un docteur dirigeant cinq élèves. Voici, à la date du novembre, la composition de ce personnel :
1ère Escouade :
M. Isard, docteur, chef d'escouade ; élèves : MM. Gadey, Zdzitowieski, Bartozzewiecz, Staes, Jovile.
2e Escouade :
M. Rozier, docteur, chef d'escouade ; élèves : MM. Leboucher. Jongla, Dubosq, Goldstein, Dorville.
3e Escouade :
M, Jacquème, docteur, chef ; élèves : MM. Chauvin, Poussin, Mégevand, Mercadier, Kalbfleisch.
4e Escouade :
M. Andrieux, docteur, chef ; élèves : MM. Petrini, Delguey, Ullé, Saint-Joseph, Lupus.
5e Escouade :
M. Bocquillon, docteur, chef ; élèves : MM. docteur Rabejac, Bercaru, Ursulesco, de Roquetaillade, Hercod.
Deux brancardiers-porteurs et une estafette.
Le local réservé à l'Ambulance mobile de la Maison-Blanche était la salle d'attente des voyageurs. Elle contenait six lits fournis par la philanthropie des personnes du voisinage. Ces lits servaient au repos des médecins et élèves de service pendant la nuit, au pansement des blessés pendant le jour.
À Villejuif, l'un des points les plus tourmentés pendant le siège, toute une maison servait d'ambulance annexe ; celle-ci se trouvait placée sur la route de Choisy-le-Roi, sous le feu de Bicêtre, entre les redoutes du Moulin-Saquet et des Hautes -Bruyères, et ne put, malgré son importance, mais à cause de sa situation, montrer avec ; éclat Futilité des Ambulances de la Presse, Chacun de ces postes est pourvu de nombreux brancards, de brancards-lits, de boites à pansement, de havresacs, de gourdes, de bandes, de charpie, de gouttières, de paillassons, des médicaments indispensables, etc.; en un mot, du même matériel que celui de Ouest-Ceinture.
Dans les divers combats qui ont été livrés sous Paris, cette ambulance a fonctionné avec une grande activité.
L'Ambulance mobile de la Maison-Blanche a conduit dans Paris, au moyen de ses trois voitures quotidiennes et d'autres voitures de la Presse, 1420 malades ou blessés, dont les noms ont été fidèlement enregistrés (militaires ou gardes recueillis aux postes avancés du Moulin-Saquet, des Hautes-Bruyères, de Vitry, de Villejuif, et sur toute la zone d'action qui s'étendait du chemin de Sceaux au chemin de fer d'Orléans).
Nombre approximatif envoyé dans les Ambulances de la Presse, 800.
Elle a soigné parmi la population du quartier, hommes, femmes et enfants, 160.
Le nombre des blessés que son personnel a pansés aux combats de l'Hay, de Chevilly, de Villiers, de Brie-sur-Marne, du Bourget, de Rueil et Montretout, où elle était réunie aux autres Ambulances mobiles, peut être évalué à 350. Tous ces blessés ont été ramenés dans l'intérieur de Paris par les voitures de la Presse.
Ce qui donnerait un total minimum de 1930 blessés ou malades soignés par les 30 médecins de cette Ambulance, depuis le 23 septembre 1870 jusqu'au 3 février 1871.
Sur la guerre de 70 et le siège de Paris
Le siège, 19 septembre 1870 - 28 janvier 1871
23 septembre
24 septembre
1er octobre
5 octobre
7 octobre
11 octobre
16 octobre
19 octobre
25 octobre
28 octobre
6 novembre
17 novembre
22 novembre
29 novembre
30 novembre
23 décembre
Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871
11 mars
Autres aspects
Le 13e avant et durant la Commune
(18 mars - 28 mai 1871)
Après l'armistice, 28 janvier - 17 mars 1871
A travers Paris
- L’ambulance mobile de la Maison-Blanche
- La question des victuailles (Le Siècle, 8 février 1871)
- A travers les rues bombardées (Le Siècle, 16 mars 1871)
L'affaire des Gobelins
- Proclamation du ministre de l’Intérieur aux habitants de Paris (4 mars 1871)
- Les faits selon le Bien Public (6 mars 1871)
- Lettre adressée au Cri du Peuple (9 mars 1871)
- Proclamation d'Emile Duval (Le Rappel, 9 mars 1871)
- Les canons de la place d'Italie (La Liberté, 9 mars 1871)
- L'opinion du Figaro (11 mars 1871)
- A travers le 13e arrondissement (11 mars 1871)
- Les canons de la Barrière d’Italie (Le Bien public — 17 mars 1871)
- La question des canons (L'Illustration, 18 mars 1871)
Démission de M. Pernolet, maire du 13e
- Démission de M. Pernolet, maire des Gobelins (Le Figaro, 7 mars 1871)
- Un maire bourgeois (Le Cri du Peuple, 8 mars 1871)
- Gazette nationale ou le Moniteur universel, 13 mars 1871
- La proclamation de M. Pernolet
Sur le 13e arrondissement
Du 18 mars au 20 mai
Journée du 18 mars
- La journée du 18 mars sur la rive gauche (Gazette nationale ou le Moniteur universel — 20 mars 1871)
Les élections du 26 mars
Journée du 5 avril
Journée du 12 avril
Journée du 14 avril
Journée du 19 avril
Journée du 4 mai
Journée du 6 mai
Du 21 au 28 mai
Journée du 24 mai
Journée du 25 mai
L'incendie des Gobelins (25 mai 1871)
Le massacre des Dominicains d'Arcueil
Les faits
- Le massacre des Dominicains, récit de l'abbé Grandcolas (L'Illusttration, 3 juin 1871)
- Les Dominicains d’Arcueil (Maxime Du Camp, Les convulsions de Paris)
Le procès (à venir)
- Ouverture du procès : rapport du capitaine Leclerc
- Rapport du capitaine Leclerc, suite, journée du 25 mai
- Audition de Serizier (personnalité)
- Audition de Serizier (interrogatoire au fond)
- Audition de Boin
- Audition de Louis Lucipia
- Audition de Jules-Constant-Désiré Quesnot
- Auditions de Gironce, Annat, Rouillac et Grapin
- Auditions de Busquaut, Gambette, Pascal







 Charles Le Boucq (1868-1959) fut député du 13ème arrondissement de 1906 à 1928. Spécialisé dans les questions économiques, il présida le groupe d'action économique, rapporta divers budgets, notamment ceux du ravitaillement, des essences et pétroles, de la marine marchande, ainsi que le projet de loi sur la production d'ammoniaque synthétique. Après son échec de 1928, Charles Le Boucq abandonna la carrière politique.
Charles Le Boucq (1868-1959) fut député du 13ème arrondissement de 1906 à 1928. Spécialisé dans les questions économiques, il présida le groupe d'action économique, rapporta divers budgets, notamment ceux du ravitaillement, des essences et pétroles, de la marine marchande, ainsi que le projet de loi sur la production d'ammoniaque synthétique. Après son échec de 1928, Charles Le Boucq abandonna la carrière politique.